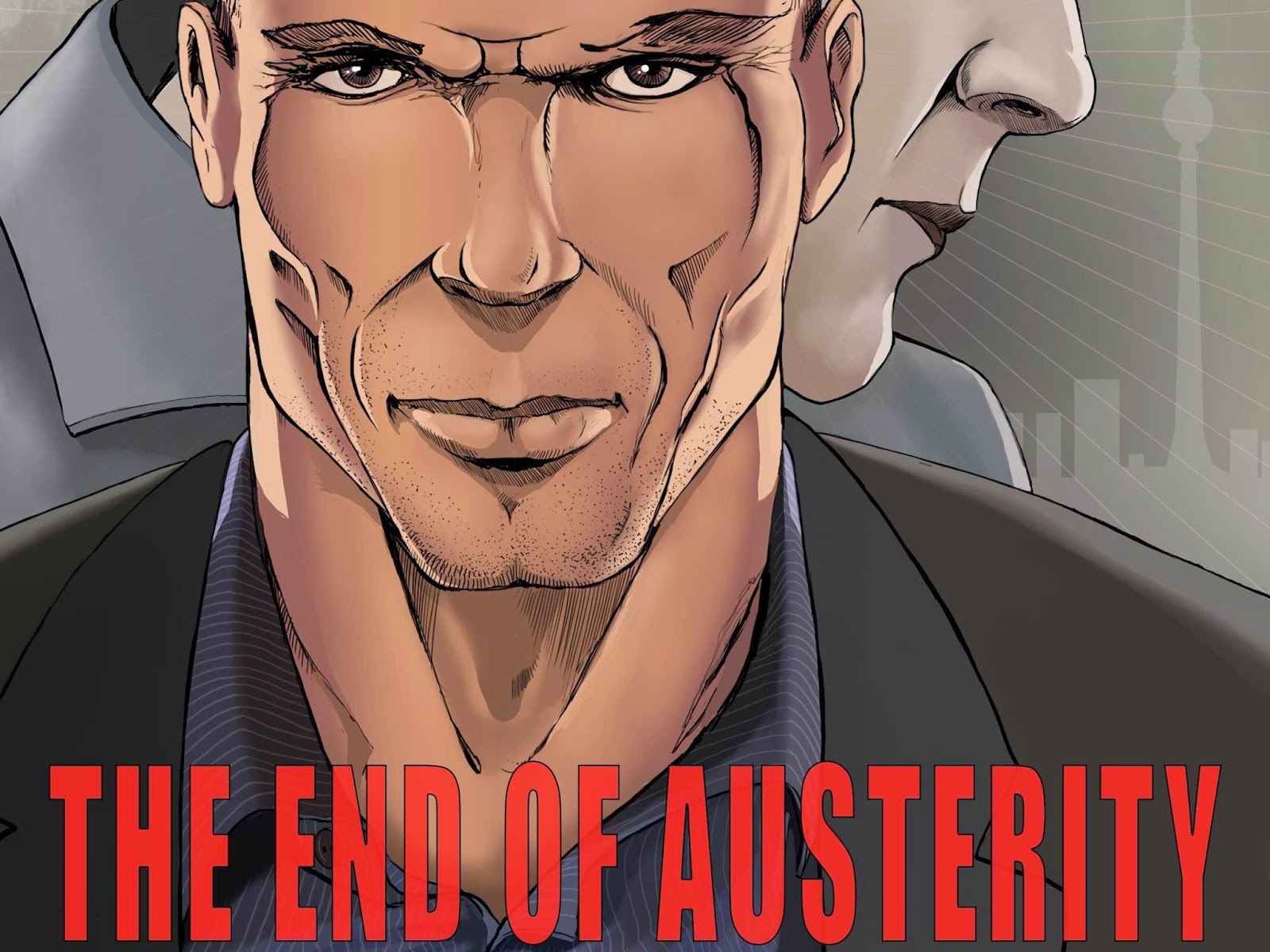MAJ de la page : La réorganisation du monde : Vers la fin du cash / La réorganisation du monde : la fin des monnaies nationales
Emission radio RTS (8 juin 2015) : Faut-il abolir le cash ?
Avec :
Bruno Bertez, entrepreneur, ancien propriétaire de l’Agefi France, blogueur spécialiste de l'information financière, Samuel Bendahan, économiste et député socialiste au Grand Conseil vaudois, et Horace Gautier, avocat et président du Cercle Libéral de Genève.
Faut-il abolir le cash ?
Par Bruno Bertez, le 13 juin 2015
La guerre contre le cash se déroule sur cinq fronts. Faute de distinguer entre ces différents fronts, la confusion s’installe et le débat devient impossible.
Premier front, celui de la macro-économie. La suppression du cash est suggérée par certains pour accélérer la vitesse de rotation de la monnaie et ainsi favoriser la reprise économique. Le cash serait en quelque sorte une sorte d’obstacle à la bonne transmission des politiques économiques et singulièrement à celles des mesures non-conventionnelles, comme les taux zéro ou négatifs.
Second front, celui de la rentabilité des banques. Les syndicats bancaires font valoir que la manipulation du cash coûte cher (très cher disent-ils). Ils vont jusqu’à chiffrer le coût de l’usage du cash bien entendu en omettant celui des solutions alternatives. Les banques ne vont pas jusqu’à chiffrer le bénéfice supplémentaire qu’elles tireront des commissions sur l’usage des cartes, etc.
Troisième front, celui de la sécurité bancaire. Si les déposants ne peuvent retirer leur argent cash des banques commerciales, alors les ruées, les « runs », les paniques qui font tomber les banques deviennent impossibles.
Toute conscience est conscience de quelque chose. Parler de "conscience sans objet" est-ce alors parler pour ne rien dire ?
Affichage des articles dont le libellé est economie. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est economie. Afficher tous les articles
lundi 15 juin 2015
samedi 16 mai 2015
Les statistiques font-elles la loi ?
MAJ de la page : Alain Supiot
Esprit de justice par Antoine Garapon
Les statistiques font-elles la loi ? 14.05.2015
« Un gouvernement par les règles mais pas par les hommes » : tel était l’idéal de la cité grecque et demeure au-delà, l’horizon de toute démocratie. Mais les règles, que sont-elles au juste ? Elles sont certes faites par les citoyens mais en retour elles donnent corps au socius en le représentant. C’est ce qui fait la référence dogmatique du droit. Mais voici que le gouvernement est tenté de radicaliser cette dimension impersonnelle en substituant aux hommes des instruments « objectifs » de mesure, comme des statistiques ou des algorithmes. C’est cette dérive qui menace aujourd’hui les institutions du droit, et c’est ce que dénonce un ouvrage qui vient de sortir d’un juriste, professeur au Collège de France qui sera l’invité d’esprit de justice aujourd’hui.
Invité(s) :
Alain Supiot, professeur au Collège de France, Directeur de l'Institut d'études avancées de Nantes, auteur de « L'esprit de Philadelphie : La justice sociale face au marché total ».
Son dernier livre :
La Gouvernance par les nombres, Ed. Fayard 2015
Commande sur Amazon : La Gouvernance par les nombres
Esprit de justice par Antoine Garapon
Les statistiques font-elles la loi ? 14.05.2015
« Un gouvernement par les règles mais pas par les hommes » : tel était l’idéal de la cité grecque et demeure au-delà, l’horizon de toute démocratie. Mais les règles, que sont-elles au juste ? Elles sont certes faites par les citoyens mais en retour elles donnent corps au socius en le représentant. C’est ce qui fait la référence dogmatique du droit. Mais voici que le gouvernement est tenté de radicaliser cette dimension impersonnelle en substituant aux hommes des instruments « objectifs » de mesure, comme des statistiques ou des algorithmes. C’est cette dérive qui menace aujourd’hui les institutions du droit, et c’est ce que dénonce un ouvrage qui vient de sortir d’un juriste, professeur au Collège de France qui sera l’invité d’esprit de justice aujourd’hui.
Invité(s) :
Alain Supiot, professeur au Collège de France, Directeur de l'Institut d'études avancées de Nantes, auteur de « L'esprit de Philadelphie : La justice sociale face au marché total ».
Son dernier livre :
La Gouvernance par les nombres, Ed. Fayard 2015
Commande sur Amazon : La Gouvernance par les nombres
jeudi 14 mai 2015
La science économique est-elle plurielle ?
La Grande table (2ème partie) par Caroline Broué
La science économique est-elle plurielle ? 14.05.2015
A quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose ? Cette question - qui est le titre d'un manifeste signé par de grands noms des sciences sociales - est assez peu posée, peut-être parce qu'elle interroge la scientificité de l'économie. Quelles visions du monde et de la discipline s'affrontent dans le débat actuel sur la place des "hétérodoxes" à l'université ?
Avec André Orléan, économiste, directeur d’études à l’EHESS, signataire du manifeste :
A quoi servent les économistes s’ils disent tous la même chose ? Ed. Les Liens qui Libèrent, 2015.
Ce livre est avant tout un cri d’alarme. Depuis plusieurs années, on assiste à une uniformisation dramatique de la pensée économique. Cette affaire n’est pas anecdotique parce qu’elle affecte la vie quotidienne de tous les citoyens. Elle a pour enjeu le choix des politiques qui ne peuvent se réduire aux seules conceptions néolibérales. Ce manifeste raconte comment une orthodoxie a fini par étouffer la diversité des conceptions. Il a pour point de départ une lettre dans laquelle l’économiste Jean Tirole jette tout le poids de son récent prix Nobel pour bloquer une réforme visant à restaurer le pluralisme des doctrines économiques à l’université. Dès réception, sa destinataire, Geneviève Fioraso, à l’époque secrétaire d’état à l’enseignement supérieur, retire son décret.
Voilà donc un économiste libéral qui demande à l’État d’intervenir pour l’aider à maintenir sa position de monopole dans l’ordre universitaire et une ministre de gauche qui obtempère. Pourtant il fut un temps où la gauche n’avait pas peur des pensées économiques alternatives et des débats d’idées.
Quatrième de couverture
Commande sur Amazon : À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose ?
Olivier Favereau et André Orléan, Economistes néo-classiques contre hétérodoxes (Xerfi Canal, 2015)
Voir aussi la page : Quelle est la valeur de la monnaie ?
jeudi 19 février 2015
Ce n'est pas l'heure pour les jeux en Europe
“Ce n’est pas l’heure pour les jeux en Europe”
Par Yanis Varoufakis, New YorkTimes, le 17 février 2015
ATHÈNES — J’écris cet article en marge d’une négociation cruciale avec les créanciers de mon pays – une négociation dont le résultat pourrait marquer toute une génération, et même s’avérer être le tournant décisif de l’expérience européenne d’une union monétaire. Les théoriciens des jeux analysent les négociations comme si elles étaient des jeux où des joueurs purement motivés par leur intérêt personnel se partagent un gâteau. Parce que j’ai passé de nombreuses années durant ma précédente vie en tant que chercheur universitaire à étudier la théorie des jeux, certains journalistes ont présumé hâtivement que, en tant que nouveau ministre des finances de la Grèce, j’élaborais activement des bluffs, des stratagèmes et des options de sortie, m’efforçant au mieux d’améliorer une mauvaise main.
Rien ne pourrait être plus loin de la vérité.
dimanche 18 janvier 2015
Peut-on fonder une pensée économique du don ?
La Grande table (2ème partie) par Caroline Broué
Peut-on fonder une pensée économique du don ? 25.12.2014
avec Le sociologue Alain Caillé, auteur de l'essai Anti-utilitarisme et paradigme du don, Ed. Le Bord de l'eau, 2014
Commande sur Amazon : Anti-utilitarisme et paradigme du don : Pour quoi ?
Il est professeur émérite de sociologie à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Source (et suite) du texte) : wikipedia
Bibliographie : wikipedia
Pr Alain Caille, Bien commun et anthropologie du don (Common Good Forum, 2013)
vendredi 2 janvier 2015
Vivre à la bonne heure avec Patrick Viveret
Dialogues en humanité (2014)
Site officiel : Dialogues en humanité
Patrick Viveret, La Sobriété heureuse (Canal-U, 2009)
mercredi 3 décembre 2014
Mondialisation : fin du début ou début de la fin ?
DÉCHIFFRAGE
Mondialisation : fin du début ou début de la fin ? (France, 2014)
Prises dans une course folle à la compétitivité, les multinationales mondiales se sont imposées, de gré ou de force, aux quatre coins de la planète. Mais à quel prix, et pour combien de temps encore ? Alternant des entretiens avec des économistes, des historiens et des philosophes, et des archives décalées, "Déchiffrage" s’interroge sur le déclin éventuel de la mondialisation.
Si vous l’achetez aujourd’hui, un téléphone portable neuf transitera par plus de vingt pays avant d’atteindre le fond de votre poche. Prises dans une course folle à la compétitivité, les multinationales mondiales se sont imposées, de gré ou de force, aux quatre coins de la planète. Mais à quel prix, et pour combien de temps encore ? Alternant des entretiens avec des économistes, des historiens et des philosophes, et des archives décalées, Déchiffrage s’interroge sur le déclin éventuel de la mondialisation. Et des débuts du commerce international aux limites actuelles du système, la revue documentaire se demande si l’on n’assiste pas à la fin d’un modèle économique dépassé, qui a péché par excès de gourmandise.
Démondialisation ?
Coup d’arrêt de la progression de la mondialisation financière, États de plus en plus réticents face aux investissements étrangers, recentrage de la Chine sur son marché intérieur... : autant de signes qui laissent présager ce retrait. Mais au-delà de la crise globale et du désastre écologique en cours, la fin de la mondialisation, dont l’influence est actuellement déterminante sur notre quotidien, nos démocraties et le niveau des inégalités, ne tendrait-elle pas aussi vers un repli nationaliste ? En tout état de cause, l’importance de la mondialisation pourrait avoir été surestimée et le recul de la finance internationale serait peut-être déjà amorcé. Et si la démondialisation avait commencé ?
Source : Arte
lundi 3 novembre 2014
Le monde selon Stiglitz
Jacques Sarasin, Le Monde selon Stiglitz (France, Arte, 2007)
Ce portrait "éclairant" de l'un des esprits les plus brillants du XXème siècle est finalement un message d'espoir. Un remarquable outil pour décrypter la mondialisation et la crise financière. Pour Joseph Stiglitz, un autre monde est possible !
Dans ce documentaire percutant sur les dangers et les perspectives de la mondialisation, le lauréat du Prix Nobel Joseph E. Stiglitz nous emmène dans un tour du monde qui débute à Gary, sa ville natale, dans la banlieue de Chicago. Lors de ce périple, de l’Equateur en Inde en passant par le Botswana et la Chine, Stiglitz explique que la mondialisation n’est pas uniquement synonyme de catastrophes environnementales ou de pressions accrues au niveau des salaires et des conditions de travail. Il existe en effet des pays qui ont parfaitement maîtrisé la mondialisation et ont réussi à en tirer parti à leur avantage. Les gouvernements conscients des dangers potentiels que représentent des marchés échappant à tout contrôle, les attaques portées à l’environnement et les limites du libre-échange, peuvent opter pour de nouvelles voies qui pourraient profiter à des centaines de millions d’individus aux quatre coins de la planète.
Source : Arte
Le prix de l'inégalité avec Joseph Stiglitz (France Inter, 2012)
Emission France Inter (réécouter)
L'austérité a échoué
Selon un vieil adage, si les faits ne correspondent pas à la théorie, il faut changer la théorie. Mais trop souvent il est plus facile de garder la théorie et de changer les faits. C'est en tout cas ce que semblent croire la chancelière Angela Merkel et d'autres dirigeants européens partisans de l'austérité. Malgré les faits qui sautent aux yeux, ils continuent à nier la réalité.
L'austérité a échoué. Mais ses défenseurs prétendent le contraire sur la base de la preuve la moins tangible qui soit : l'économie n'est plus en chute libre. Mais si tel est le critère utilisé, on pourrait tout aussi bien affirmer que sauter d'une falaise est le meilleur moyen d'arriver en bas.
Toute crise se termine un jour. Il ne faut donc pas conclure à la réussite d'une politique du seul fait de la reprise économique, mais l'évaluer à l'aune des dommages dus à la crise et du temps qu'il aura fallu pour en sortir.
De ce point de vue, l'austérité a été un désastre complet. C'est évident si l'on considère les pays de l'Union européenne qui sont à nouveau au bord de la stagnation, si ce n'est d'une récession à triple creux, avec un chômage qui reste à des sommets et dans beaucoup de pays un PIB réel par habitant (corrigé de l'inflation) toujours inférieur à son niveau d'avant-crise. Même dans les pays qui s'en sortent le mieux comme l'Allemagne, depuis la crise de 2008, la croissance est tellement faible que dans d'autres circonstances on la qualifierait de lamentable.
Les pays les plus touchés sont en dépression. Il n'y a pas d'autres mots pour décrire l'économie de l'Espagne ou de la Grèce, où près d'un quart de la population (et plus de la moitié des jeunes) est au chômage.
Source (et suite) du texte : La Presse (30.07.2014)
Joseph Eugene Stiglitz est un économiste américain né le 9 février 1943. Il a reçu en 2001 le « prix Nobel » d’économie, pour un travail commun avec George Akerlof et Michael Spence. Il est l’un des fondateurs et des représentants les plus connus du « nouveau keynésianisme ». Il a acquis sa notoriété populaire à la suite de ses violentes critiques envers le FMI et la Banque mondiale, émises peu après son départ de la Banque mondiale en 2000, alors qu’il y était économiste en chef.
Source (et suite) du texte : wikipedia
Voir aussi la page : Le testament de Maurice Allais
jeudi 16 octobre 2014
Le testament de Maurice Allais
Les commentateurs économiques que je vois s'exprimer régulièrement à la télévision pour analyser les causes de l'actuelle crise sont fréquemment les mêmes qui y venaient auparavant pour analyser la bonne conjoncture avec une parfaite sérénité. Ils n'avaient pas annoncé l'arrivée de la crise, et ils ne proposent pour la plupart d'entre eux rien de sérieux pour en sortir. Mais on les invite encore. Pour ma part, je n'étais pas convié sur les plateaux de télévision quand j'annonçais, et j'écrivais, il y a plus de dix ans, qu'une crise majeure accompagnée d'un chômage incontrôlé allait bientôt se produire. Je fais partie de ceux qui n'ont pas été admis à expliquer aux Français ce que sont les origines réelles de la crise alors qu'ils ont été dépossédés de tout pouvoir réel sur leur propre monnaie, au profit des banquiers. Par le passé, j'ai fait transmettre à certaines émissions économiques auxquelles j'assistais en téléspectateur le message que j'étais disposé à venir parler de ce que sont progressivement devenues les banques actuelles, le rôle véritablement dangereux des traders, et pourquoi certaines vérités ne sont pas dites à leur sujet. Aucune réponse, même négative, n'est venue d'aucune chaîne de télévision et ce, durant des années.
Cette attitude répétée soulève un problème concernant les grands médias en France : certains experts y sont autorisés et d'autres, interdits. Bien que je sois un expert internationalement reconnu sur les crises économiques, notamment celles de 1929 ou de 1987, ma situation présente peut donc se résumer de la manière suivante : je suis un téléspectateur. Un prix Nobel... téléspectateur. Je me retrouve face à ce qu'affirment les spécialistes régulièrement invités, quant à eux, sur les plateaux de télévision, tels que certains universitaires ou des analystes financiers qui garantissent bien comprendre ce qui se passe et savoir ce qu'il faut faire. Alors qu'en réalité ils ne comprennent rien. Leur situation rejoint celle que j'avais constatée lorsque je m'étais rendu en 1933 aux Etats-Unis, avec l'objectif d'étudier la crise qui y sévissait, son chômage et ses sans-abri : il y régnait une incompréhension intellectuelle totale. Aujourd'hui également, ces experts se trompent dans leurs explications. Certains se trompent doublement en ignorant leur ignorance, mais d'autres, qui la connaissent et pourtant la dissimulent, trompent ainsi les Français.
Cette ignorance et surtout la volonté de la cacher grâce à certains médias dénotent un pourrissement du débat et de l'intelligence, par le fait d'intérêts particuliers souvent liés à l'argent. Des intérêts qui souhaitent que l'ordre économique actuel, qui fonctionne à leur avantage, perdure tel qu'il est. Parmi eux se trouvent en particulier les multinationales qui sont les principales bénéficiaires, avec les milieux boursiers et bancaires, d'un mécanisme économique qui les enrichit, tandis qu'il appauvrit la majorité de la population française mais aussi mondiale.
Question clé : quelle est la liberté véritable des grands médias ? Je parle de leur liberté par rapport au monde de la finance tout autant qu'aux sphères de la politique.
Deuxième question : qui détient de la sorte le pouvoir de décider qu'un expert est ou non autorisé à exprimer un libre commentaire dans la presse ?
Dernière question : pourquoi les causes de la crise telles qu'elles sont présentées aux Français par ces personnalités invitées sont-elles souvent le signe d'une profonde incompréhension de la réalité économique ? S'agit-il seulement de leur part d'ignorance ? C'est possible pour un certain nombre d'entre eux, mais pas pour tous. Ceux qui détiennent ce pouvoir de décision nous laissent le choix entre écouter des ignorants ou des trompeurs.
Cette attitude répétée soulève un problème concernant les grands médias en France : certains experts y sont autorisés et d'autres, interdits. Bien que je sois un expert internationalement reconnu sur les crises économiques, notamment celles de 1929 ou de 1987, ma situation présente peut donc se résumer de la manière suivante : je suis un téléspectateur. Un prix Nobel... téléspectateur. Je me retrouve face à ce qu'affirment les spécialistes régulièrement invités, quant à eux, sur les plateaux de télévision, tels que certains universitaires ou des analystes financiers qui garantissent bien comprendre ce qui se passe et savoir ce qu'il faut faire. Alors qu'en réalité ils ne comprennent rien. Leur situation rejoint celle que j'avais constatée lorsque je m'étais rendu en 1933 aux Etats-Unis, avec l'objectif d'étudier la crise qui y sévissait, son chômage et ses sans-abri : il y régnait une incompréhension intellectuelle totale. Aujourd'hui également, ces experts se trompent dans leurs explications. Certains se trompent doublement en ignorant leur ignorance, mais d'autres, qui la connaissent et pourtant la dissimulent, trompent ainsi les Français.
Cette ignorance et surtout la volonté de la cacher grâce à certains médias dénotent un pourrissement du débat et de l'intelligence, par le fait d'intérêts particuliers souvent liés à l'argent. Des intérêts qui souhaitent que l'ordre économique actuel, qui fonctionne à leur avantage, perdure tel qu'il est. Parmi eux se trouvent en particulier les multinationales qui sont les principales bénéficiaires, avec les milieux boursiers et bancaires, d'un mécanisme économique qui les enrichit, tandis qu'il appauvrit la majorité de la population française mais aussi mondiale.
Question clé : quelle est la liberté véritable des grands médias ? Je parle de leur liberté par rapport au monde de la finance tout autant qu'aux sphères de la politique.
Deuxième question : qui détient de la sorte le pouvoir de décider qu'un expert est ou non autorisé à exprimer un libre commentaire dans la presse ?
Dernière question : pourquoi les causes de la crise telles qu'elles sont présentées aux Français par ces personnalités invitées sont-elles souvent le signe d'une profonde incompréhension de la réalité économique ? S'agit-il seulement de leur part d'ignorance ? C'est possible pour un certain nombre d'entre eux, mais pas pour tous. Ceux qui détiennent ce pouvoir de décision nous laissent le choix entre écouter des ignorants ou des trompeurs.
Le prix Nobel d'économie légitime-t-il la mondialisation ?
Planète terre par Sylvain Kahn
Le prix Nobel d'économie légitime-t-il la mondialisation ? 15.10.2014
avec :
Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint d'Alternatives Economiques
Alexandre Delaigue, professeur d'économie à l’université Lille 1
En cette période de remise des prix Nobel, Planète terre s'intéresse au prix Nobel "coucou" : le "prix de la Banque centrale de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel". Créé en 1969 seulement, est-il objectif, pluraliste ou est-il le reflet d'une pensée économique dominante, pro-mondialisation libérale par exemple ? A l'image des trois disciplines "nobélisées", la physique, la chimie et la médecine, ce prix consacre-t-il la scientificité de l'économie, ou accrédite-t-il la représentation que l'économie est une science ? A-t-il un impact sur les politiques publiques, les banquiers centraux, les marchés et les orientations des acteurs économiques ? Peut on dire que, dans la durée, son attribution accompagne, reflète ou oriente la globalisation? Ou bien, l'attribution du surnommé "prix Nobel d'économie" n'a-t-il pas plus d'influence que les distinctions académiques auxquelles, en fin de compte, il s’apparenterait - et dont il serait la plus prestigieuse et/ou la plus médiatisée ?
Source : FC
* * *
Alfred Bernhard Nobel, né le 21 octobre 1833 à Stockholm (Suède) et mort le 10 décembre 1896 à San Remo (Italie), est un chimiste, industriel et fabricant d'armes suédois. Inventeur de la dynamite, il possédait l'entreprise d'armement Bofors. Dans son testament, il légua son immense fortune pour la création du prix Nobel. L'élément chimique nobélium a été nommé ainsi en son honneur.
Source (et suite) du texte : wikipedia
samedi 6 septembre 2014
On remet tout à plat...
Interview de Paul Jorion, économiste, On remet tout à plat... et on fait quoi ? (Lyon Vidéo, 2014)
Site officiel : Paul Jorion / Blog
"Ce qui est tout à fait destructeur autour de nous (...) c'est la croissance. Le fait que nous devions à tout moment avoir des systèmes économiques en croissance. Pourquoi devons-nous avoir des systèmes économiques en croissance ? (...)
La croissance est uniquement nécessaire pour payer les intérêts. Si on veut payer les intérêts de quelque chose il faut que l'argent viennent d'une nouvelle richesse créé, il ne peut pas venir de l'intérieur du système tel qu'il est déjà, (...)
Que faire ? - Supprimer la spéculation (...), supprimer l'intérêt (...), supprimer la monnaie (...)
Demain matin on se réveille, il n'y a plus d'argent !"
Paul Jorion, né le 22 juillet 19462 à Bruxelles, est un chercheur en sciences sociales, de nationalité belge, ayant fait usage des mathématiques dans de nombreux champs disciplinaires : anthropologie, sciences cognitives, et économie.
Il a enseigné dans les universités de Bruxelles, Cambridge, Paris-VIII et de Californie à Irvine. Il a également été fonctionnaire des Nations-unies (FAO), participant à des projets de développement en Afrique. Il détient depuis 2012 la chaire « Stewardship of Finance » (la finance au service de la communauté), à la Vrije Universiteit Brussel.
Source (et suite) du texte : wikipedia
* * *
L'An 01 est un film français de 1973, réalisé par Jacques Doillon, Gébé, Alain Resnais et Jean Rouch. Il est adapté de la bande dessinée L'An 01 de Gébé.
Le film narre un abandon utopique, consensuel et festif de l'économie de marché et du productivisme. La population décide d'un certain nombre de résolutions dont la première est « On arrête tout » et la deuxième « Après un temps d'arrêt total, ne seront ranimés — avec réticence — que les services et les productions dont le manque se révélera intolérable. Probablement : l'eau pour boire, l'électricité pour lire le soir, la TSF pour dire “Ce n'est pas la fin du monde, c'est l'an 01, et maintenant une page de Mécanique céleste” ». L'entrée en vigueur de ces résolutions correspond au premier jour d'une ère nouvelle, l'An 01.
L'An 01 est emblématique de la contestation des années 1970 et aborde des thèmes aussi variés que l'écologie, la négation de l'autorité, l'amour libre, la vie en communauté, le rejet de la propriété privée et du travail.
Source (et suite) du texte : wikipedia
samedi 5 avril 2014
Le système énergétique global est-il au bord du court-circuit ?
Planète terre par Sylvain Kahn
Le système énergétique global est-il au bord du court-circuit ? (26.03.2014)
L'énergie est au coeur des activités humaines. Mais il n'y a pas d'énergie sans nuisances. Quels sont les différents types d'énergie ? Comment se répartissent les gisements ? Ont-ils tous le même impact sur l'environnement ? Quels sont les défis qui devront être relevés ? Ou en sommes-nous de la transition énergétique ?
avec :
Bernadette Mérenne-Schoumaker, professeure à l'Université de Liege
Jean-Louis Bobin, professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie
Benoit Thévard, ingénieur conseil
Source : FC
samedi 12 octobre 2013
Vers un crash alimentaire
Vers un crash alimentaire (France, 2008)
Conjuguées au dérèglement climatique, les logiques économiques actuelles conduisent à brève échéance à une catastrophe alimentaire planétaire. Est-il trop tard pour inverser la tendance ?
La récente flambée des prix agricoles a été un coup de semonce : jamais le monde n’avait affronté une crise alimentaire d’une telle ampleur. Mais comme le montre l’enquête d’Yves Billy et Richard Prost, les difficultés ne font que commencer. Les stocks mondiaux de céréales baissent depuis huit années consécutives et n’assurent plus à la population mondiale qu’une avance de vingt jours d’alimentation, bien en deçà du niveau officiel de sécurité fixé à soixante-dix jours. Aujourd’hui, rappellent-ils, 925 millions de personnes souffrent de la faim sur la planète et leur nombre croît de plus en plus vite. À la hausse du prix des matières premières, à la raréfaction de l’eau et des surfaces arables et aux ravages causés par les dérèglements climatiques, se sont ajoutés deux phénomènes récents : au moment même où la demande chinoise en céréales s’accélérait brutalement, les biocarburants ont commencé à redessiner la carte de l’agriculture mondiale. Par exemple, la production américaine d’éthanol à base de maïs, qui engloutit le tiers des récoltes du pays, devrait passer de 80 millions de tonnes en 2007 à 120 millions cette année. Quant au productivisme agricole, qui en un demi-siècle a épuisé les sols et pollué l’environnement, il a atteint ses limites. Tout comme le dogme néolibéral, qui a poussé les pays du Sud à tout miser sur des cultures d’exportation, mettant la survie des populations locales à la merci des cours mondiaux. De plus en plus nombreuses, des voix s’élèvent pour que ces logiques économiques soient remises à plat, même au sein du FMI et de la Banque mondiale, afin de prendre en compte les besoins des différents pays, y compris des plus pauvres.
Nourrir les hommes ou l’économie ?
Les réalisateurs ont enquêté en Europe, interrogé de nombreux spécialistes de l’agriculture et de l’alimentation, parcouru les exploitations céréalières de l’Argentine et des États-Unis, puis traversé une Chine en voie d’urbanisation accélérée. Pour parvenir à nourrir sa population, celle-ci investit désormais à l’extérieur de ses frontières, en Afrique, en Corée du Sud et, justement, en Argentine. Avec l’exemple du maïs et du soja, deux cultures majoritairement livrées aux OGM, que l’industrie, mais aussi l’élevage intensif, disputent à l’alimentation humaine, ils nous permettent de comprendre très concrètement pourquoi la demande agricole grimpe alors que l’offre baisse. Une démonstration accablante, qui nous interroge : sommes-nous capables de modifier le cours de cette catastrophe annoncée ?
Source : Arte
mercredi 9 octobre 2013
Jeux de pouvoirs et régulation bancaire
Jeux de pouvoir et régulation bancaire (France, 2013)
Éprouvées par la crise de 2008, la France et l'Union européenne tentent de reprendre la main face aux marchés. Cette enquête à suspense nous introduit dans les coulisses du pouvoir, révélant un éreintant bras de fer entre mondes bancaire et politique.
Source (et suite) du texte : Arte
mardi 13 août 2013
Un monde dans tous ses états
Un monde dans tous ses états, un film d'Hubert Védrine réalisé par Oscar Lévy (France, 2012)
Fin de croissance à crédit et des folies financières, imprudence des banques, explosion de la dette publique, démographie galopante, aggravation des écarts de richesse, urbanisation tentaculaire, changement climatique, raréfaction des ressources, généralisation de la pollution, effondrement de la biodiversité, risques persistants de conflits, « gouvernance » mondiale introuvable, convulsions dans la zone euro… aujourd’hui, tous les voyants sont au rouge.
Source (et suite) du texte : Arte
dimanche 28 juillet 2013
Economie casino
La logique de profit des banques «détruit l'économie réelle».
Le fonctionnement actuel de la finance mondiale est contraire à l'esprit du libéralisme et détruit l'économie réelle, dénonce Marc Chesney, professeur en finance à l'Université de Zurich.
L'introduction d'une taxe sur les transactions financières pourrait y remédier, selon lui.
Et il revient à la Suisse, en particulier, de montrer l'exemple en prenant les devants, souligne le chercheur dans un entretien publié dans la NZZ am Sonntag.
Un prélèvement de 0,1% sur chaque transaction suffirait d'après lui à éliminer le trading à haute fréquence. Ce procédé permettant via des programmes informatiques algorithmiques l'exécution à grande vitesse d'opérations boursières est jugé problématique par Marc Chesney, car il présente d'importants risques pour la stabilité du système financier international. Il est impossible qu'en une fraction de seconde des données fondamentales à propos d'une entreprise ne soient communiquées. Les investisseurs utilisent justement cette avance pour générer rapidement des gains. Par ailleurs, une banque ne devrait pas pouvoir spéculer sur la faillite d'une entreprise ou mettre en circulation des instruments financiers opaques, tels les produits structurés. Ces dispositifs complexes ne profitent pas à l'économie réelle et ne bénéficient d'ailleurs souvent qu'aux banques.
«La complexité est un facteur de profit et de pouvoir», indique Marc Chesney. La valeur nominale totale du marché des produits dérivés représente ainsi près d'un dixième de l'activité économique mondiale. Selon une statistique établie par le Fonds monétaire international (FMI), le volume total des dérivés échangés s'élève à 640 milliards de dollars (594 milliards de francs), alors que toutes les économies nationales du monde réunies ne génèrent chaque année «que» 72 milliards de dollars.
Les grandes banques et les courtiers en bourse sont si puissants qu'ils ont le pouvoir de dicter leur politique financière aux gouvernements et à la société, et ce depuis des années. Par ailleurs, le fait que les Etats soient venus au secours de grandes banques au bord de la faillite est contraire à la logique libérale, qui voudrait que celui qui prend des risques en assume les conséquences.
Source : TdG (28 juillet 2013)
Les bourses mondiales sont à nouveau florissantes, les indices sont au plus haut. Wall Street a même franchi vendredi la barre des 15'000 points - un record, et un contraste saisissant avec la morosité économique ambiante. La zone euro est en panne de croissance; les chiffres du chômage atteignent des niveaux dramatiques dans plusieurs pays européens. Comment expliquer cette dichotomie? La bourse est-elle saisie d’une "exubérance irrationnelle", pour reprendre la formule d’Alan Greenspan, ancien patron de la Réserve fédérale américaine (FED) ?
Interview : RTS (mp3, 21' - 7 mai 2013)
Source : RTS
lundi 27 mai 2013
Que faire ? Tim Jackson
Que faire ? Des personnalités exposent leurs idées pour sauver la planète. Aujourd'hui : l'économiste anglais Tim Jackson, théoricien de la fin de la croissance. (Allemagne, 2011)
TED, Tim Jackson ramène l'économie à la réalité (2010)
Colloque Fondation Nicolas Hulot, "Vers quelle prospérité ?" (2010)
« Prospérité sans croissance: de la conception à l'action » Table ronde grand public avec Tim Jackson organisée par l'Université Catholique de Louvain (2011)
Tim Jackson, Prospérité sans croissance, Ed. De Boeck, 2010
Commande sur Amazon : Prospérité sans croissance : La transition vers une économie durable
mardi 21 mai 2013
Faut-il en finir avec la religion de la croissance ?
Du Grain à moudre par Hervé Gardette
Faut-il en finir avec la religion de la croissance avec Tomáš Sedláček
Tomáš Sedláček est économiste, conférencier et professeur d'université en République tchèque. Il fut conseiller économique, à 24 ans, de l'ancien président Vdclav Havel. En 2006, la Yale Economic Review l'a classé parmi les jeunes économistes les plus talentueux du moment. Il est aujourd'hui conseiller économique à la banque CSOB à Prague.
Qu'est-ce que l'économie ? Pourquoi est-elle trop souvent considérée comme une science exacte ? Pourquoi sommes-nous si dépendants de la croissance permanente ? D'où vient l'idée du progrès économique et où nous conduit-elle ? Tomas Sedlacek se pose ces questions fondamentales et y répond en envisageant l'économie non pas comme une science, mais comme un phénomène culturel et un produit de notre civilisation étroitement liés à la philosophie, aux mythes, à la religion, à l'anthropologie et aux arts. En soutenant une thèse simple, presque hérétique, selon laquelle l'économie relève en définitive d'un choix constant entre le bien et le mal, il bouleverse radicalement l'approche actuelle, comme personne avant lui.
Tomáš Sedláček, L'économie du bien et du lam, Ed. Eyrolles, 2013
Commande sur Amazon : L'économie du bien et du mal. La quête de sens économique.
jeudi 2 mai 2013
Pauvre de nous
PAUVRE DE NOUS, documentaire de Ben Lewis (2012, 52mn)
Du Néolithique à la crise actuelle du capitalisme, une histoire de la pauvreté éclairée par les propos d’experts renommés.
Historiens et économistes, dont Joseph Stiglitz, lauréat du Nobel d’économie, décrivent les multiples facettes de la misère selon les époques et les régions du monde. Aux temps préhistoriques, l’extrême précarité était le lot commun de tous les chasseurs-cueilleurs tandis qu’au Moyen Âge, elle semble devenir le moteur du système, avec la charité comme seul remède. La pauvreté serait-elle la conséquence des déprédations et de la colonisation ? L’internationalisation des échanges et l’industrialisation seraient-elles à la racine du mal ? Des séquences d’animation viennent illustrer cette odyssée chronologique. Le film met en scène de multiples personnages plus pauvres les uns que les autres, et nous confronte à la misère moderne et à son origine principale : les inégalités...
Source : Arte
Inscription à :
Articles (Atom)