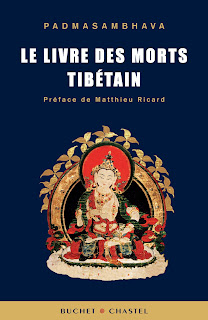Toute conscience est conscience de quelque chose. Parler de "conscience sans objet" est-ce alors parler pour ne rien dire ?
Affichage des articles dont le libellé est conscience. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est conscience. Afficher tous les articles
jeudi 18 août 2016
Quelle conscience dans le coma ?
Quelle conscience dans le coma ?
Avec Sarah Wannez, neuropsychologue à l'Université de Liège et au Centre hospitalier universitaire de Liège, Belgique.
Grâce aux progrès de la médecine, on maintient en vie des patients souffrant de graves lésions cérébrales, dans un état appelé "coma". Comment pouvons-nous déterminer s'ils sont conscients ou inconscients ? Comment les diagnostiquer ? Souffrent-ils ? Quel traitement existe? Quelles questions éthiques leurs cas soulèvent-ils ?
Source : FC
dimanche 24 juillet 2016
Conscience et réalité
MAJ de la page : Francis Lucille
La Conscience est la réalité
Pourquoi ce qui change est moins réel ?
"La nature réelle de l'illusion c'est la croyance que les objets sont quelque chose d'autre que la conscience, qu'ils ont une existence indépendante de la conscience
De ce fait, vous avez trois étapes de connaissance :
1) L'ignorance dans laquelle les objets sont réels,
2) la reconnaissance de la réalité de la conscience dans laquelle la conscience est réelle, et les objets considérés comme existants indépendamment de la conscience sont une illusion,
3) les objets n'étant rien d'autre que conscience sont réels, en tant que conscience, la conscience est la réalité de l'objet."
La conscience est la réalité absolue qui perçoit.
Que ressent-on quand on se sait être la conscience ?
Qu'est-ce que la loi d'abondance ?
Autres vidéos : Francis Lucille Youtube Vidéos / Francis Lucille Youtube Playlist
Site officiel : Francis Lucille
La Conscience est la réalité
Pourquoi ce qui change est moins réel ?
"La nature réelle de l'illusion c'est la croyance que les objets sont quelque chose d'autre que la conscience, qu'ils ont une existence indépendante de la conscience
De ce fait, vous avez trois étapes de connaissance :
1) L'ignorance dans laquelle les objets sont réels,
2) la reconnaissance de la réalité de la conscience dans laquelle la conscience est réelle, et les objets considérés comme existants indépendamment de la conscience sont une illusion,
3) les objets n'étant rien d'autre que conscience sont réels, en tant que conscience, la conscience est la réalité de l'objet."
La conscience est la réalité absolue qui perçoit.
Que ressent-on quand on se sait être la conscience ?
Qu'est-ce que la loi d'abondance ?
Autres vidéos : Francis Lucille Youtube Vidéos / Francis Lucille Youtube Playlist
Site officiel : Francis Lucille
dimanche 1 février 2015
Que savons-nous sur.. la conscience ?
En cas de problème avec le player : cliquez ici
Science publique par Michel Alberganti
Club Science publique: Que savons-nous sur.. la conscience ? 30.01.2015
Avec :
Steven Laureys, neurologue, dirige le “coma science group” au centre de recherche de l’université de Liège
Pierre-Henri Gouyon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'Agro Paris-Tech et à Sciences Po
Aude Bernheim, ingenieure des Ponts Eaux et Forêts, doctorante à l'Institut Pasteur
Fabrizia Stavru, chargée de recherche CNRS, elle travaille au sein de l'Unité des interactions Bactéries-Cellules à l'Institut Pasteur.
Steven Laureys, Le coma et la conscience, (TEDsParis, 2013)
mardi 9 septembre 2014
Emmanuel Ransford à Genève
Emmanuel Ransford
« La Conscience a-t-elle une origine quantique »
Vendredi 19 septembre 2014
Salle Centrale de la Madeleine à Genève, 20h00
Organisation : ISSNOE
Le monde quantique est étrange et fascinant. Emmanuel Ransford nous emmène à sa découverte en des termes imagés et accessibles. De sa réflexion originale sur le hasard quantique émerge une explication sur l'origine de la Conscience. Cette hypothèse inhabituelle et potentiellement testable a des conséquences étonnantes concernant nos facultés psychiques connues et moins connues. Des exemples concrets illustreront son propos.
Emmanuel Ransford est chercheur indépendant spécialiste de physique quantique, épistémologue et conférencier, diplômé de l'Ecole Polytechnique. Il s'intéresse aux fondements de la physique contemporaine et plus particulièrement aux comportements si étranges des systèmes quantiques. Son idée directrice est que l'étrangeté des quantas s'explique par la présence d'une dimension non-physique dans la matière, qui devient alors holomatière. Cette hypothèse audacieuse débouche sur la notion de conscience quantique, qu'il présente dans son dernier livre intitulé " La conscience quantique et l'au-delà" (2013, éd. Guy Trédaniel).
Source : ISSNOE
Voir la page : Physique quantique et spiritualité avec Emmanuel Ransford
vendredi 12 avril 2013
Les animaux pensent-ils ?
Gabi Schlag et Benno Wenz, Les animaux pensent-ils ? (Allemagne, 2012)
On a longtemps cru que les animaux n'agissaient que par instinct. Mais des chercheurs ont conçu une batterie de tests étonnants qui tendent à prouver que les bêtes sont tout à fait capables de réfléchir.
Ils sont zoologue, ethnologue, psychologue, biologiste ou cogniticien et se passionnent pour le comportement des bêtes. Ces chercheurs ont conçu une batterie de tests étonnants. Un cacatoès saura-t-il ouvrir cinq verrous différents ? Un chimpanzé reconstituera-t-il une suite de quinze nombres ? Un pigeon parviendra-t-il à entraîner sa mémoire visuelle par "économie de pensée" ? Un chien réagira-t-il à une phrase ? Un orang-outan récupérera-t-il une cacahuète dans un tube en verre ? Un corbeau se rappellera-t-il le cri d’un congénère côtoyé des années plus tôt ? Toutes espèces confondues, le règne animal prouve qu’il dispose de trésors d'inventivité, que l’apprentissage existe et que sa curiosité peut l’amener à progresser en reproduisant des gestes. La distance vis-à-vis de l’être humain s'amenuise. Les petits d’homme avancent parfois même moins vite que les chimpanzés dans la résolution d’un problème !
Source (et suite) du texte : Arte
samedi 6 avril 2013
Doit-on encore manger de la viande ?
MAJ de la page : Hors menu
Avec un documentaire Arte (2012)
Doit-on encore manger de la viande ?
Les amateurs de viande, toujours plus nombreux, en mangent de plus en plus. Et bien que de nombreuses études scientifiques démontrent qu’une consommation excessive de viande est mauvaise pour la santé, les habitudes alimentaires n’évoluent guère. Bien au contraire. D’après certaines estimations, la production de viande va doubler à l’échelle planétaire au cours des 35 prochaines années. Où cela nous mènera-t-il ? La Thema de ce soir présente, outre les différentes formes d’élevage en batterie, les conséquences écologiques de cette augmentation de la production de viande, qui vont de la raréfaction de l’eau potable au changement climatique en passant par la pollution de l’environnement.
Source : Arte
Dossier Arte : Doit-on encore manger des animaux ?
Avec un documentaire Arte (2012)
Doit-on encore manger de la viande ?
Les amateurs de viande, toujours plus nombreux, en mangent de plus en plus. Et bien que de nombreuses études scientifiques démontrent qu’une consommation excessive de viande est mauvaise pour la santé, les habitudes alimentaires n’évoluent guère. Bien au contraire. D’après certaines estimations, la production de viande va doubler à l’échelle planétaire au cours des 35 prochaines années. Où cela nous mènera-t-il ? La Thema de ce soir présente, outre les différentes formes d’élevage en batterie, les conséquences écologiques de cette augmentation de la production de viande, qui vont de la raréfaction de l’eau potable au changement climatique en passant par la pollution de l’environnement.
Source : Arte
Dossier Arte : Doit-on encore manger des animaux ?
vendredi 15 mars 2013
Coma et conscience
COMA ET CONSCIENCE
Alors étudiante en archéologie, Tamara Grübel a un accident de voiture et passe plusieurs mois dans le coma. À son réveil, elle est devenue aveugle et a perdu une partie de ses fonctions cérébrales. Aujourd'hui, elle reparle français et anglais, réapprend à jouer du violoncelle, à monter à cheval et s'efforce de lire en braille. La jeune femme, ses parents et sa soeur, son médecin et ses auxiliaires de vie racontent ce long chemin vers la rémission. Le documentaire évoque aussi le cas de Trees, une mère de famille néerlandaise de 52 ans, dans le coma, également en raison d'un accident de la route. À Liège, elle est examinée par une équipe médicale qui a élaboré un protocole clinique pour évaluer précisément le degré de conscience des patients dans le coma. Pendant une semaine, les médecins examinent les réactions du cerveau à divers stimuli et expérimentent de nouveaux médicaments. Une exploration de la conscience humaine, aux frontières de la médecine, de la technologie et de la philosophie.
(Allemagne, 2013, 53mn)
Source : Arte 7
Date(s) de rediffusion :
Samedi, 23 mars 2013, 13h05
Jeudi, 11 avril 2013, 10h20
mardi 25 octobre 2011
Isabelle Ratié
Isabelle Ratié, docteur en philosophie (2009, EPHE, Sorbonne, Paris), est chercheuse à l’Institut für Indologie und Zentralasienwissenschaften (université de Leipzig). Elle a publié plusieurs articles sur la Pratyabhijñā et prépare actuellement l’édition critique et la traduction du chapitre II, 4 de l’Īśvarapratyabhijñāvimarśinī d’Abhinavagupta.
Source du texte : Brill
Si les récents travaux de recherche consacrés au śivaïsme ont permis de mieux comprendre les dimensions religieuses des mouvements śivaïtes médiévaux, les aspects proprements philosophiques de certains des textes produits dans ces milieux demeurent largement méconnus. La présenté étude [Le Soi et l'Autre] se propose de contribuer à combler cette lacune en explorant le système philosophique complexe et original élaboré par les śivaïtes non dualistes cachemiriens Utpaladeva (925-975) et Abhinavagupta (975-1025). Montrant que ce système ne se réduit pas à une exégèse scripturaire, l’ouvrage examine la genèse des concepts de la philosophie de la Pratyabhijñā ou “Reconnaissance” en prenant en compte la complexité du champ philosophique (déjà investi par divers courants aussi bien bouddhiques que brahmaniques) dans lequel la pensée d’Utpaladeva s’est développée.
Source du texte : Brill
Bibliographie (en français) :
- Le Soi et l’Autre. Identité, différence et altérité dans la philosophie de la Pratyabhijñā, Jerusalem Studies in Religion and Culture 13, Brill, Leiden, 2011, 785 pp.
Commande sur Amazon : Le Soi et l'Autre : Identite, Difference et Alterite dans la Philosophie de la Pratyabhijna
- Le non-être, une preuve de l’existence du Soi ? La notion d’abhāva dans la philosophie de la Pratyabhijñā, Journal Asiatique 298 (2), 2010, pp. 421-493
- La Mémoire et le Soi dans l’Īśvarapratyabhijñāvimarsinī d’Abhinavagupta, Indo-Iranian Journal 49 (1-2), 2006, pp. 39-103.
En ligne : Introduction aux problèmes de la philosophie indienne classique et médiéval (compte rendu d'un cycle de conférences)
Bibliographie exhaustive : Université de Leipzig
Introduction - Le non-être et la stratégie de la Pratyabhijna.
Rien n'est plus ordinaire que l'expérience du non-être : il n'est pas d'existence pratique sans la compréhension familière que tel objet manque, que telle personne est absente, que telle chose n'est pas telle autre. Cette compréhension a pourtant quelque chose de mystérieux : comment pouvons-nous prendre conscience de ce qui semble devoir échapper à toute perception parce que cela n'est rien ? (...)
Extrait de : Le non-être, une preuve de l’existence du Soi ? La notion d’abhāva dans la philosophie de la Pratyabhijñā, Journal Asiatique 298 (2), 2010, pp. 421-493
(...)
Il est vrai que cette reconnaissance émerveillée de soi n'est en rien garantie par la raison. Comme Utpaladeva l'admet lui-même, les plus belles démonstrations de cette absence de contradiction ne produisent pas nécessairement, chez un sujet empirique pourtant saturé de bonne volonté, la réalisation de son identité avec la conscience absolue. Car dans un système qui fait une place aussi immense à la liberté, la nécessité de la raison n'est contraignante qu'à condition que la conscience veuille bien se laisser contraindre, et même si la démarche rationnelle du traité parvient au but que la Pratyabhijna lui assigne, il demeure un gouffre entre l'admission théorique de la possibilité de dire du Soi qu'il est le Seigneur décrit par Utpaladeva et Abhinavagupta, et la pleine réalisation de cette identité. Ce gouffre, paradoxalement, n'est qu'un écart infinitésimal, la "pointe" évanouissante d'un acte cognitif : le sujet qui fait nécessairement l'expérience de sa pure subjectivité lorsqu'il comprend l'inférence constituée par le traité est toujours libre d'ignorer cette expérience au-delà du temps et cependant nichée au coeur de la temporalité, de laisser passer cet instant fugitif dans lequel il n'est plus que la conscience absolue d'être conscience absolue - il lui suffit de ne porter attention qu'à l'état intermédiaire de l'acte cognitif dans lequel il s'appréhende lui-même comme un sujet saisissant un objet conceptuel distinct de lui, et de se laisser emporter, instant après instant, dans le flot des concepts, sans jamais prendre pleine conscience de la subjectivité dont sourd et dans laquelle se résorbe constamment ce flot. En dernière instance, c'est donc de la grâce (anugraha) seule que dépend la Reconnaissance : la raison ne peut que mettre en évidence une évidence à laquelle la conscience peut toujours refuser de se rendre. De ce point de vue, le système de la Pratyabhijna a quelque chose de profondément tragique - ou de profondément comique, comme on voudra : ce ne sont là sans doute que deux aspects partiels que recouvre la notion de jeu (drita) de la conscience -, car la grâce des sivaites non dualistes n'est certes pas le bon vouloir d'un dieu lointain, mais celui de la conscience elle-même choisissant de s’apparaître aliénée, elle n'en demeure pas moins appréhendée par le sujet aliéné comme le bon vouloir d'un Autre auquel il demeure désespérément suspendu, précisément parce que le sujet empirique est la conscience s'apparaissant comme aliénée. (...)
Extrait (sans les notes) de : Le Soi et l’Autre. Identité, différence et altérité dans la philosophie de la Pratyabhijñā, Jerusalem Studies in Religion and Culture 13, Brill, Leiden, 2011, 785 pp.
Commande sur Amazon : Le Soi et l'Autre : Identite, Difference et Alterite dans la Philosophie de la Pratyabhijna .
.
Introduction - Le non-être et la stratégie de la Pratyabhijna.
Rien n'est plus ordinaire que l'expérience du non-être : il n'est pas d'existence pratique sans la compréhension familière que tel objet manque, que telle personne est absente, que telle chose n'est pas telle autre. Cette compréhension a pourtant quelque chose de mystérieux : comment pouvons-nous prendre conscience de ce qui semble devoir échapper à toute perception parce que cela n'est rien ? (...)
Extrait de : Le non-être, une preuve de l’existence du Soi ? La notion d’abhāva dans la philosophie de la Pratyabhijñā, Journal Asiatique 298 (2), 2010, pp. 421-493
(...)
Il est vrai que cette reconnaissance émerveillée de soi n'est en rien garantie par la raison. Comme Utpaladeva l'admet lui-même, les plus belles démonstrations de cette absence de contradiction ne produisent pas nécessairement, chez un sujet empirique pourtant saturé de bonne volonté, la réalisation de son identité avec la conscience absolue. Car dans un système qui fait une place aussi immense à la liberté, la nécessité de la raison n'est contraignante qu'à condition que la conscience veuille bien se laisser contraindre, et même si la démarche rationnelle du traité parvient au but que la Pratyabhijna lui assigne, il demeure un gouffre entre l'admission théorique de la possibilité de dire du Soi qu'il est le Seigneur décrit par Utpaladeva et Abhinavagupta, et la pleine réalisation de cette identité. Ce gouffre, paradoxalement, n'est qu'un écart infinitésimal, la "pointe" évanouissante d'un acte cognitif : le sujet qui fait nécessairement l'expérience de sa pure subjectivité lorsqu'il comprend l'inférence constituée par le traité est toujours libre d'ignorer cette expérience au-delà du temps et cependant nichée au coeur de la temporalité, de laisser passer cet instant fugitif dans lequel il n'est plus que la conscience absolue d'être conscience absolue - il lui suffit de ne porter attention qu'à l'état intermédiaire de l'acte cognitif dans lequel il s'appréhende lui-même comme un sujet saisissant un objet conceptuel distinct de lui, et de se laisser emporter, instant après instant, dans le flot des concepts, sans jamais prendre pleine conscience de la subjectivité dont sourd et dans laquelle se résorbe constamment ce flot. En dernière instance, c'est donc de la grâce (anugraha) seule que dépend la Reconnaissance : la raison ne peut que mettre en évidence une évidence à laquelle la conscience peut toujours refuser de se rendre. De ce point de vue, le système de la Pratyabhijna a quelque chose de profondément tragique - ou de profondément comique, comme on voudra : ce ne sont là sans doute que deux aspects partiels que recouvre la notion de jeu (drita) de la conscience -, car la grâce des sivaites non dualistes n'est certes pas le bon vouloir d'un dieu lointain, mais celui de la conscience elle-même choisissant de s’apparaître aliénée, elle n'en demeure pas moins appréhendée par le sujet aliéné comme le bon vouloir d'un Autre auquel il demeure désespérément suspendu, précisément parce que le sujet empirique est la conscience s'apparaissant comme aliénée. (...)
Extrait (sans les notes) de : Le Soi et l’Autre. Identité, différence et altérité dans la philosophie de la Pratyabhijñā, Jerusalem Studies in Religion and Culture 13, Brill, Leiden, 2011, 785 pp.
Commande sur Amazon : Le Soi et l'Autre : Identite, Difference et Alterite dans la Philosophie de la Pratyabhijna
vendredi 19 août 2011
S.Y.N.A.P.S.E
Fin de semaine avec un communiqué d'IBM annonçant les premiers résultats du projet S.Y.N.A.P.S.E. (Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics)
devant aboutir à une nouvelle génération de microprocesseurs fonctionnant à l'exemple des connexions neuronales. Si le chemin se révèle praticable, ce serait un bond en avant pour l'intelligence artificielle puisque ces puces seraient capables d'apprentissage et de décisions autonomes.
Un pas de plus vers l'émergence d'une conscience artificielle ?
IBM travaille sur des puces expérimentales qui imitent le cerveau humain
IBM a créé des puces expérimentales sachant imiter le mode de fonctionnement du cerveau humain. Selon lui, il s'agit d'une avancée « sans précédent » sur le chemin de la création d'ordinateurs intelligents capables de collecter, de traiter et de comprendre rapidement les données informatiques.
« La puce expérimentale devrait permettre aux ordinateurs de prendre des décisions après avoir rassemblé et analysé d'immenses quantités de données, comme le fait l'être humain quand il compulse des informations pour comprendre une série d'événements », explique Dharmendra Modha, chef de projet chez IBM Research. Ces puces prototypes, dont le modèle est inspiré des systèmes neuronaux, imitent la structure du cerveau et son fonctionnement, à la différence près que cela se passe dans des circuits de silicium, à l'aide d'algorithmes complexes. « IBM espère qu'en reproduisant le fonctionnement du cerveau humain dans une puce, il pourra faire évoluer les ordinateurs pour en faire des machines hautement parallèles, capables de penser par événement, et peu gourmandes en énergie », indique le chef de projet.
Les futures machines au comportement humain seront très éloignées des ordinateurs actuels, limités en puissance de calcul et qui nécessitent d'être programmés par l'homme pour produire des résultats. «Ces machines vont permettre de dépasser les limites fondamentales des ordinateurs actuels », a ajouté Dharmendra Modha. « On ne pourra pas soutenir des vitesses d'horloge toujours plus élevées. En revanche, le cerveau humain représente l'ordinateur parfait. »
Des connexions qui s'organisent dynamiquement
Comme le cerveau humain, les puces expérimentales d'IBM peuvent organiser leurs connexions dynamiquement afin de sentir, comprendre et agir en fonction d'informations collectées par la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher, mais aussi réagir à l'analyse d'autres sources, comme la météo ou le contrôle de l'approvisionnement en eau. « Les puces aideront à découvrir des modèles basés sur les probabilités et la mise en relation des informations. Mais elles vont devoir rivaliser avec la taille compacte du cerveau et ses faibles besoins en énergie », a déclaré le chef de projet d'IBM Research. «Nous avons désormais à notre disposition les éléments d'une nouvelle architecture qui peut nous permettre d'effacer, d'une manière toujours plus efficace, la frontière entre le monde physique et le monde numérique », a déclaré Dharmendra Modha.
« Ces puces pourraient aider à gérer l'approvisionnement en eau grâce à une analyse des données en temps réel et une capacité de reconnaissance des formes », explique encore le chef de projet. Reliés à un réseau de capteurs de surveillance mesurant la température, la pression, la hauteur des vagues et des marées océaniques, les ordinateurs équipés de ces puces pourraient lancer des alertes au tsunami. Ces puces aux fonctions cognitives pourraient aussi aider les grossistes à repérer les produits défectueux et doter les smartphones de fonctionnalités permettant de mieux interagir avec l'environnement. IBM et ses partenaires ont déjà appliqué les résultats de leurs recherches pour tester un parcours dans un labyrinthe, un jeu de Pong, ou pour trouver des motifs dans une série de données. Les chercheurs cherchent à obtenir de meilleurs résultats dans la reconnaissance d'images dans une vidéo.
Des phénomènes électriques identiques à ceux des neurones.
IBM a réalisé deux puces expérimentales selon le processus de fabrication à 45 nanomètres. Les circuits utilisés sont des circuits classiques mais sont organisées de manière à recréer des phénomènes électriques identiques à ceux des neurones et des synapses dans le cerveau humain, avec des capacités de mémoire, de calcul et de communication intégrées. « Les puces sont fabriquées avec les mêmes transistors utilisés dans la fabrication des microprocesseurs actuels, mais leur câblage est différent », a déclaré Dharmendra Modha. Les processeurs intègrent des « neurones digitaux » autonomes qui fonctionnent comme des unités de traitement basse énergie, et des synapses pour établir les connexions entre eux.
Les neurones et les synapses sont organisés en grille dans une infrastructure de communication qui permet aux neurones d'échanger entre eux des données en temps réel. Les neurones mémorisent les activités récentes, et les synapses se souviennent à quels neurones elles sont associées. Chaque puce abrite 256 « neurones digitaux ». Ceux-ci fonctionnent à une vitesse de 10MHz seulement et échangent en permanence des informations entre eux. L'une des puces contient 262 144 synapses programmables et l'autre 65 536 synapses « d'apprentissage ». Comme dans le cerveau, la synapse établit des connexions entre les neurones digitaux. La fréquence d'un signal envoyé à une synapse détermine la force de la synapse.
Selon le chef de projet, il serait possible d'équiper les ordinateurs actuels avec des unités de traitement basse énergie pour obtenir ce mode de fonctionnement. Mais les bus qui séparent les unités de traitement sont des goulets d'étranglement. Or, à mesure que l'afflux de données augmente, il faut que les noyaux soient capables de fonctionner à des fréquences d'horloge plus rapides. « La fonctionnalité de la puce peut être simulée sur les ordinateurs actuels. Mais les ordinateurs actuels sont très différents du cerveau humain. Alors il faut compenser par la puissance et le volume », explique Dharmendra Modha.
Les puces expérimentales reproduisent un cerveau humain simplifié, doté pour sa part de 100 milliards de neurones et plusieurs milliards de synapses. Selon IBM, ces puces annoncent une machine intelligente qui peut éventuellement être comparée à un « système à l'échelle du mammifère », avec 10 milliards de neurones et 100 000 milliards de synapses, dont la consommation d'énergie et la taille serait proche du cerveau humain. Pour l'instant, le chercheur d'IBM Research ne s'est pas avancé pour dire dans quel délai un tel ordinateur pourrait être réalisé. Mais il pense que les résultats de la recherche actuelle pourraient influer sur la façon dont on construit les ordinateurs.
Développées dans le cadre du projet SyNAPSE
Le cerveau humain est aussi capable de penser « hors des sentiers battus » pour diriger une action, alors quel degré d'intelligence auront réellement ces puces ? Selon le chef de projet d'IBM Research, la puce saura imiter les fonctionnalités du cerveau humain et les neurones digitaux pourront être soumis à un large éventail de stimuli et d'environnements de façon à répondre à des situations de plus en plus variées.
Ces puces ont été développées par IBM avec des partenaires, dans le cadre du projet de recherche SyNAPSE (Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics) mené sur plusieurs années et centré sur l'informatique cognitive. Il réunit des compétences en neurosciences, en nanotechnologies et dans le domaine des supercalculateurs pour mettre au point cette nouvelle plate-forme informatique. Parmi les partenaires associés à IBM dans la recherche, on compte l'Université de Columbia, l'Université Cornell, l'Université Merced de Californie et l'Université Madison du Wisconsin. IBM et ses partenaires ont également annoncé qu'ils avaient reçu une contribution supplémentaire de 21 millions de dollars de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), une agence du Département américain de la Défense chargée de la recherche et du développement de nouvelles technologies pour un usage militaire.
Sources anglaises : IBM / PCWorld / Venturebeat
jeudi 21 juillet 2011
Vasubandu
Le terme sanskrit Vasubandhu signifie littéralement la bonne parenté, vasu bon ou excellent, et bandhu parenté . D'où est issu son nom traduit en chinois Shiqin (Shìqīn parenté de génération en génération) ou Tianqin (Tiānqīn parenté céleste), son nom chinois de la transcription phonétique Poxiupantou (póxiūpántóu), ou Posoupandou (pósǒupándòu) ou Fasupandu (fásūpándù) n'est quasiment plus utilisé. Son nom en tibétain est dbyig gnyen.
Ses écrits, dont le plus important est le Trésor de l’Abhidharma (Abhidharmakośa), traduits en chinois et en tibétain, ont exercé une influence importante sur les bouddhismes mahāyāna et vajrayāna.
Source du texte : wikipedia
Bibliographie :
- Vijñaptimātratāsiddhi : deux traités de Vasubandhu : viṃśatika et triṃsikā , trad. Sylvain Lévi, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes. Sciences historiques et philologiques fasc. 245, 1925
- Abhidharmakosa, traduit et annoté par Louis de la Vallée Poussin, Paul Geuthner, Paris, 1926.
- Cinq traités sur l'esprit seulement, trad. Philippe Cornu], Fayard, collection "Trésors du bouddhisme", Paris, 2008.
- Jean-Marc Vivenza, Tout est conscience : une voie d'éveil bouddhiste, Albin Michel, col. Spiritualités vivantes, 2010.
1
Toutes choses sont seulement perception,
Elles n'ont pas d'existence, mais sont perçues en tant qu'objets.
Comme l'illustre l'exemple des malades atteints d'ophtalmie qui voient des cheveux ou une lune là où il n'y a rien,
Aucun objet n'a d'existence réelle.
A ces mots on pourrait objecter :
2 (Objection)
Mais si la perception n'a pas d'objet extérieur,
Il ne saurait y avoir de lieux et de moments déterminés,
Il serait de même illogique que plusieurs esprits (perçoivent le même objet),
Et (nul objet) n'assumerait sa fonction !
Expliquons d'abord ces objections :
Quand ce produit par exemple la perception d'une forme sans qu'il y ait d'objet correspondant, si ladite perception ne découle pas de la présence d'un objet externe comme une forme, pourquoi cela se produit-t-il dans un lieu précis et non pas n'importe où ? Et dans ce lieu défini, l'évènement arrive à un moment particulier et non tout le temps. Comment donc expliquer que cette perception surgit dans l'esprit de tous ceux qui se trouvent à cet endroit-là à un moment précis et non dans l'esprit d'un seul d'entre-eux, comme pour l'homme affecté d'ophtalmie qui perçoit des cheveux là ou personne d'autre n'en voit ? Enfin, pourquoi les cheveux ou les mouches volantes que voit cet homme affligé d'ophtalmie n'assument-ils pas la fonction propre aux cheveux, (aux mouches) et ainsi de suite, alors que les mêmes objets perçus par d'autres personnes assument cette fonction ?
La nourriture, la boisson, les vêtements, le poison ou les armes que l'on voit en rêve n'accomplissent nullement leur fonction nourricière, désaltérante, etc., mais il en va tout autrement pour les objets (réels).
Une cité aérienne de mangeurs de parfums, de par son inexistence même, n'accomplit point la fonction d'une cité, mais il n'en va pas de même pour les autres cités. Si donc ces objets sont vraiment inexistants, il est tout simplement impossible de déterminer lieu et temps, mais aussi la pluralité des esprit (qui perçoivent un même phénomène) et l'efficience des phénomènes.
- Non, ce n'est pas absurde, car :
3 (Réponse)
La détermination de l'espace (et du temps)
Est établie comme elle l'est dans les rêves.
"Comme dans les rêves", c'est-à-dire de la même manière qu'en rêve. Comment cela ? Dans un rêve, aucun objet extérieur n'intervient et pourtant il s'y manifeste divers phénomènes tels qu'abeilles, jardins, hommes et femmes, en des endroits précis et non n'importe où. Et dans ces lieux déterminés, ces mêmes phénomènes apparaissent à des moments précis et non pas n'importe quand. Par conséquent, même en l'absence d'objet réellement existants, lieux et temps sont clairement définis.
(...)
Extrait de La Vingtaine et son auto-commentaire dans Cinq traits sur l'esprit seulement, trad. Philippe Cornu, Ed.Fayard.
Commande sur : Amazon
L'Abidharmakosabhasya (trad. Louis de la Vallée Poussin) :
Suite : volume 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Introduction au Vijñānavāda (Doctrine de la Conscience) » par Stéphane Arguillère
« L’idéalisme bouddhique ou vijñānavāda (« doctrine de la conscience ») est sans doute le système de philosophie le plus ample et le plus consistant que le bouddhisme, et plus généralement la pensée non-occidentale, ait engendré (j’inclus le Proche-Orient et l'Afrique du Nord dans la sphère occidentale, puisque les pensées qui s'y sont développées se sont tout de même inscrites à bien des égards dans une filiation aristotélico-néoplatoncienne).
Ce que cette pensée a de plus curieux, c'est précisément sa problématique intégralement idéaliste, qui, au IIIe-IVe siècle de notre ère où les frères Asanga et Vasubandhu en ont déployé toutes les articulations, la rend à cet égard conceptuellement contemporaine de nos philosophes classiques, de Berkeley ou de Leibniz, plutôt que de Plotin ou de S. Augustin. Mais le plus étonnant, pour nous, est le caractère central de la notion de causalité, ou de production, dans cette forme d'idéalisme. Ce qui peut nous amener à nous poser au moins une question intéressante en termes d'histoire de la philosophie : pourquoi, chez nous, le développement de l'hypothèse idéaliste a-t-elle été de pair avec une évacuation progressivement de plus en plus complète de la notion de production causale, de la cause efficiente, dont on voit le couronnement, peut-être, chez Husserl ? Pourquoi la notion de causalité psychique, pourtant éminemment bien posée par Spinoza, a-t-elle peu à peu été évacuée de l'idéalisme moderne européen ?
Je ne tâcherai pas de répondre à cette question, qui comme telle n'intéresse pas le bouddhisme, mais d'esquisser les grandes lignes du système de l'idéalisme bouddhique en tâchant de le reconstruire (en abrégé) « selon l'ordre des raisons », un peu comme s'il avait été inventé, non pas dans le haut moyen âge indien, mais quelques décennies après Descartes. Ce qui m'amènera aussi m'interroger sur le rapport entre raison et écriture dans le bouddhisme, ou sur le caractère plus ou moins purement philosophique du système dans sa forme originale. »
Stéphane Arguillère.
Source du texte : vimeo
mardi 5 juillet 2011
Asanga
C'est pourquoi, à l’évidence, l'étude des éléments théoriques de cette école originale apparaît, à juste titre, comme nécessaire et indispensable à une parfaite connaissance de ce qui préside à l'énoncé des grandes vérités qui nous sont proposées par la tradition du « Grand Véhicule », et l'on pourrait même dire, sans crainte d'exagération, à une compréhension réelle des bases essentielles de l'Enseignement délivré originellement par le Bouddha lui-même.
Mais on sera surpris de constater qu’en Occident, la doctrine Yogâcâra se retrouve dans l'immatérialisme philosophique de George Berkeley (1685-1753), une apparente et surprenante parenté entre les thèses de Berkeley et l'enseignement de l'idéalisme Yogâcara, puisque Vasubandhu et Asanga, ont soutenu, dans un contexte religieux cette bien différent, l'inexistence du monde extérieur, en expliquant que celui-ci n'est que le fruit de constructions mentales erronées qui nous font prendre pour concret ce qui n'est qu'une conséquence de l'activité de la pensée.
Source du texte : Jean-Marc Vivenza
Autre biographie : wikipedia
Bibliographie (en français) :
- La Somme du grand véhicule, Mahayanasamgrapha, tome II, trad. Etienne Lamotte, Ed. Université Catholique de Louvain, 1973
- Le Compendium de la Super doctrine, trad. Walpola Rahula, Ed. Efeo, 1980.
- Ratnagotravibhâga/Mahâyânottaratantrashâstra, Le Message du futur Bouddha ou La lignée spirituelle des trois joyaux, trad. François Chenique, Ed. Dervy, 2001.
Etudes : Jean-Marc Vivenza, Tout est conscience, Ed. Albin Michel, Spiritualité vivante.
Soutenir, comme le faisaient les penseurs Madhyamika, que la réalité mondaine n'est qu'une illusion de par son absence de nature propre, de par sa vacuité, c'était donc positivement et objectivement admettre, si l'on suivait la logique d'Asanga et de Vasubandhu, qu'elle n'était qu'une représentation de l'esprit (manas), une pensée (vijnapati, citta); qu'elle se résumait dans son être, qu'elle n'était, concrètement, qu'une simple connaissance (vijnana), le fuit d'un mécanisme intellectuel, d'un processus mental.
"L'existence de l'idée pure, écrira Vasubhandu, se trouve établie par la connaissance même que l'on possède de l'irréalité de l'idée" (Vimshakakarika-prakarana). Asanga aura lui-même cette expression, qui restera comme emblématique, et qui donnera son nom au courant dont il est l'initiateur avec son frère cadet : si le monde n'est que de la conscience, s'il n'est que de la connaissance (vijnamatra), alors il n'est "rien que pensée", "rien que l'esprit" (cittamatra).
Extrait de : Tout est conscience
Commande sur : Amazon
Ce qui n'a ni commencement, ni milieu, ni fin, qui est indivisible et sans dualité, qui est libéré de trois façons, sans taches et sans concepts : c'est la nature de l'Essence ultime que contemplent les yogis concentrés en méditation.
Cette essence douée de qualités immenses, incomparables, inconcevables et plus nombreuses que le sable du Gange, elle a déraciné tous les défauts ainsi que les imprégnations mentales : c'est l'Essence immaculée des Tathagata.
Par les différents aspects de la vraie Doctrine, par son corps lumineux et ses efforts concertés pour délivrer tous les êtres, cette Essence est semblable en ses actions au roi des Joyaux qui exauce tous les désirs, et bien qu'elles apparaissent sous de multiples aspects, ce n'est pas là sa vraie nature.
Cette essence est la cause qui dans les divers monde fait avancer les être sur le chemin de la Pacification, les porte à maturité et prévoit leur Eveil, c'est la Forme d'apparition qui réside toujours dans cette essence ultime comme les formes visibles dans l'élément espace.
Ce qui est appelé Bouddhéité, c'est l'état omniscient de ceux qui sont "né d'eux-mêmes", c'est la béatitude suprême du Nirvana, l'inconcevable accomplissement des Arhat que l'on connait par une expérience intérieur.
Cette Bouddhéité se manifeste de diverses façons par les trois Corps : le Corps essentiel, le Corps de Béatitude, le Corps de manifestation.
1 Le Corps essentiel
En résumé, le Corps essentiel des Bouddhas a cinq caractéristiques et on doit le connaitre come doué de cinq sortes de qualités.
Le Corps essentiel a cinq caractéristiques :
1 - Il est non composé car il est de la nature de l'Essence ultime
2 - Il est indivisible car il est sans distinction conceptuelle,
3- Il est libre des deux extrêmes car il est le domaines des seuls yogis
4 - Il est exempt des trois voiles que sont les émotions perturbatrices, le connaissable et les ravissements, car il est libre de souillures,
5 - il est rayonnant par nature car il est parfaitement pur.
Le Corps essentiel est doté de 5 qualités : il est immense parce que très élevé, indénombrable parce que incalculable, inconcevable parce que hors du domaine des arguments dialectiques, incomparables parce qu'unique, et parfaitement pur parce que délivré des rémanences karmiques.
(...) Extrait de : Le message du futur Bouddha
Commande sur : Amazon
"L'existence de l'idée pure, écrira Vasubhandu, se trouve établie par la connaissance même que l'on possède de l'irréalité de l'idée" (Vimshakakarika-prakarana). Asanga aura lui-même cette expression, qui restera comme emblématique, et qui donnera son nom au courant dont il est l'initiateur avec son frère cadet : si le monde n'est que de la conscience, s'il n'est que de la connaissance (vijnamatra), alors il n'est "rien que pensée", "rien que l'esprit" (cittamatra).
Extrait de : Tout est conscience
Commande sur : Amazon
L'Ainsité non souillée.
IV ManifestationCe qui n'a ni commencement, ni milieu, ni fin, qui est indivisible et sans dualité, qui est libéré de trois façons, sans taches et sans concepts : c'est la nature de l'Essence ultime que contemplent les yogis concentrés en méditation.
Cette essence douée de qualités immenses, incomparables, inconcevables et plus nombreuses que le sable du Gange, elle a déraciné tous les défauts ainsi que les imprégnations mentales : c'est l'Essence immaculée des Tathagata.
Par les différents aspects de la vraie Doctrine, par son corps lumineux et ses efforts concertés pour délivrer tous les êtres, cette Essence est semblable en ses actions au roi des Joyaux qui exauce tous les désirs, et bien qu'elles apparaissent sous de multiples aspects, ce n'est pas là sa vraie nature.
Cette essence est la cause qui dans les divers monde fait avancer les être sur le chemin de la Pacification, les porte à maturité et prévoit leur Eveil, c'est la Forme d'apparition qui réside toujours dans cette essence ultime comme les formes visibles dans l'élément espace.
Ce qui est appelé Bouddhéité, c'est l'état omniscient de ceux qui sont "né d'eux-mêmes", c'est la béatitude suprême du Nirvana, l'inconcevable accomplissement des Arhat que l'on connait par une expérience intérieur.
Cette Bouddhéité se manifeste de diverses façons par les trois Corps : le Corps essentiel, le Corps de Béatitude, le Corps de manifestation.
1 Le Corps essentiel
En résumé, le Corps essentiel des Bouddhas a cinq caractéristiques et on doit le connaitre come doué de cinq sortes de qualités.
Le Corps essentiel a cinq caractéristiques :
1 - Il est non composé car il est de la nature de l'Essence ultime
2 - Il est indivisible car il est sans distinction conceptuelle,
3- Il est libre des deux extrêmes car il est le domaines des seuls yogis
4 - Il est exempt des trois voiles que sont les émotions perturbatrices, le connaissable et les ravissements, car il est libre de souillures,
5 - il est rayonnant par nature car il est parfaitement pur.
Le Corps essentiel est doté de 5 qualités : il est immense parce que très élevé, indénombrable parce que incalculable, inconcevable parce que hors du domaine des arguments dialectiques, incomparables parce qu'unique, et parfaitement pur parce que délivré des rémanences karmiques.
(...) Extrait de : Le message du futur Bouddha
Commande sur : Amazon
mardi 12 avril 2011
Philippe Cornu
Philippe Cornu, né en 1957, est un universitaire français étudiant le bouddhisme sous toutes ses formes, bien qu’il soit plus proche du bouddhisme vajrayâna. Docteur en ethnologie (anthropologie des religions), président de l’Université bouddhique européenne (UBE) et chargé de cours à l’INALCO, Philippe Cornu est familier du bouddhisme depuis près de 25 ans. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le bouddhisme dont un Dictionnaire Encyclopédique du Bouddhisme (800 pages).
Source du texte : Buddhachannel
L’UBE fut créee en 1996, avec le parrainage de l’UNESCO, et dans le cadre du programme « Étude Intégrale des Routes de la Soie : Routes de Dialogue ». Sa vocation est « d’offrir à un large public un accès fiable et complet aux enseignements du Bouddha ». En pratique, elle propose des formations d’étude du bouddhisme, de différents niveaux, mais il ne s’agit pas d’un centre de méditation bouddhique.
Source du texte : Wikipedia
Bibliographie :
- L’Astrologie tibétaine. 1re édition : éditions les Djinns, collection « Présences », Paris, 1990. 272 p. Nouvelle édition augmentée : Guy Trédaniel, Paris, 1999. 375 p. + 12 p.
- Longchenpa, la liberté naturelle de l'esprit. Éditions du Seuil, coll. « Points. Sagesses » n° 66, Paris, 1994.
- Padmasambhava : la magie de l’éveil (avec la collaboration de Virginie Rouanet). Éditions du Seuil, coll. « Points. Sagesses » n° 116, Paris, 1997. 275 p.
- Le miroir du cœur. Tantra du Dzogchen (traduit du tibétain et commenté par Philippe Cornu). Éditions du Seuil, coll. « Points. Sagesses », Paris, 1997. 284 p.
- Tibet : culture et histoire d’un peuple. Guy Trédaniel, collection « Le retour à l’esprit » n° 16, Paris, 1998. 63 p.
- Tibet : le rayonnement de la sagesse. Guy Trédaniel, collection « Le retour à l’esprit » n° 17, Paris, 1998. 63 p.
- Guide du bouddhisme tibétain. Librairie générale française, collection « Les guides Sélène », 1998. 351 p.
- Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme. Nouvelle édition augmentée, Éditions du Seuil, Paris, 2006. 952 p.
- Soûtra du Diamant et autres soûtras de la Voie médiane (traduit du tibétain par Philippe Cornu, du chinois et du sanskrit par Patrick Carré). Fayard, collection « Trésors du bouddhisme », Paris, 2001. 180 p.
- La terre du Bouddha (avec 250 photographies de Michel Gotin). Éditions du Seuil, Paris, 2004. 315 p.
- Soûtra du Dévoilement du sens profond : Sandhinirmocanasûtra (traduit du tibétain et commenté par Philippe Cornu). Fayard, collection « Trésors du bouddhisme », Paris, 2005. 152 p.
- « Vasubandhu : Cinq traités sur l’esprit seulement » (traduit du tibétain et commenté par Philippe Cornu), Fayard, collection "Trésors du bouddhisme", Paris, 2008. 302 p.
- « Padmasambhava : Le Livre des morts tibétain » (traduit du tibétain, introduit et commenté par Philippe Cornu), Buchet-Chastel, Paris, 2009.
- Le Bouddhisme, une philosophie du bonheur ?, 12 questions pour comprendre la voie du Bouddha, Ed. du Seuil, 2013
Source : wikipedia
Commande sur Amazon.
Votre nouvelle traduction du Livre des morts tibétain se base sur des versions tibétaines plus fiables, et elle donne la perspective véritable de ce texte en lui rendant son arrière-plan doctrinal issu de la tradition dzogchen.
L’idée principale de ce travail était de retraduire directement du tibétain, parce que jusqu’ici le texte traduit de l’anglais n’avait pas un vocabulaire adéquat. Il n’était pas lié au dzogchen alors que le texte est nyingmapa. C’est en combinant les pratiques tantriques et celles du dzogchen que le Bardo Thödol se présente comme une sorte de kit complet pour travailler avec son esprit dans la vie, pour se préparer au moment de la mort et tirer les leçons des expériences post-mortem afin d’en percevoir le côté libérateur. Tout cela ne paraissait pas clair dans les éditions précédentes, c’est pourquoi j’ai voulu donner tous les textes et les expliquer un par un. Il fallait donc repartir du texte proprement dit, corrigé de préférence, ce qui a été possible grâce à Dudjom Rinpoché, qui a fait une édition critique en tibétain où il rétablit la justesse du texte. Il fallait ensuite replacer le livre dans sa tradition. Sinon, c’est un texte qui flotte dans une aura de fantastique qui prête le flanc à toutes les projections fantasmatiques de l’Occident. Les exposés sur la nature de l’esprit font pourtant partie du noyau du Bardo Thödol, et sans eux on se retrouve avec des textes descriptifs et spectaculaires qui nous parlent de visions, de déités, etc. Cela paraît exotique voire psychédélique, ce qui a donné lieu aux délires de Timothy Leary sur l’usage du Livre des morts lors des voyages au LSD, alors que cela n’a rien à voir. Cela fausse la compréhension, parce que LSD ou pas, tant que les visions sont vues sous l’angle dualiste, elles ne sont pas libératrices et ne ramènent pas à la vraie nature de l’esprit.
Vous expliquez aussi comment Jung n’a pas compris l’Orient et en particulier ce texte ?
Ce qui est intéressant est de voir pourquoi Jung n’a pas compris la méditation à partir des catégories occidentales. La psychologie, et Jung avec elle, dépend de la pensée philosophique de Descartes, selon laquelle l’esprit est une substance pensante et non une substance étendue. Cela circonscrit l’esprit comme un espace clôt, avec des objets intérieurs à cet esprit, des représentations mentales. Avec la psychologie freudienne, cet esprit est à nouveau divisé entre conscient et inconscient puis avec Jung entre inconscient individuel et collectif. Jung a ramené ce qu’il comprenait du bouddhisme et de la méditation à ses propres catégories, il en a fait une voie royale vers l’inconscient avec tous les dangers que cela suppose. C’est pourquoi il recommande au Occidentaux de ne pas se risquer dans la méditation. Cela vient d’un présupposé selon lequel l’accès offert par la méditation serait celui de l’inconscient, alors que ce n’est pas le cas pour le bouddhisme où il n’est jamais question de cela. Certes, des choses sont sous-jacentes à la conscience, c’est ce qu’on appelle les tendances karmiques. Un karma est toute action motivée par le désir de perpétuer le sentiment du moi. Ce moi est illusoire, jamais véritablement constitué, tout le temps à reconstruire ; mais nous lui attribuons une solidité qui serait le noyau fixe de notre individualité. Pour le bouddhisme il n’y a qu’un courant de conscience en transformation perpétuelle. Nos intentions égocentriques produisent des imprégnations karmiques qui laissent une trace dans la conscience. Elles restent sous-jacentes jusqu’à ce que causes et conditions soient réunies pour donner naissance à une situation existentielle nouvelle. C’est un cycle sans fin, mais il n’y a pas l’idée d’un inconscient séparé.
Qu’entend-on par conscience dans le bouddhisme ?
Il y a huit types de conscience selon l’école de « l’esprit seul » (en sanscrit Vijnanavada, Cittamatra ou Yogacara). Cette approche, reprise par le dzogchen, décrit l’esprit à son niveau fonctionnel et relatif, l’esprit conditionné qui tourne à faux, qui ne comprend pas ce qui se produit et l’interprète, créant le sentiment de l’ego et d’un monde extérieur. Cet épiphénomène prend toute la place et masque le fait que sous cet esprit se trouve le non-duel, inconditionné, ouvert : la nature éveillée. D’abord on trouve les cinq consciences actives des sens ; puis la conscience mentale, qui à l’aide de représentations ordonne une conception du monde cohérente. Puis sont définies deux consciences qui rendent compte de la continuité de l’esprit dans les moments où les six consciences actives s’arrêtent, dans le sommeil profond par exemple. Est alors posée l’idée d’une conscience sous-jacente qui ferait le lien entre divers moments de conscience ou même entre plusieurs vies. C’est la conscience « base universelle », alayavijñana. C’est un lieu neutre où se déposent les imprégnations des karmas créés sous l’influence de l’ego. La septième conscience est le mental passionné ou souillé, klistamanas, c’est un aspect de l’esprit qui est en quête d’un support solide et stable. Il prend alors l’alayavijñana, la huitième conscience, pour le moi. C’est le Q.G. de l’ignorance, qui entretient le sentiment du moi par une cogitation constante. Comme tout est fugace, ce mental essaie de reconstruire l’ego en permanence. La septième conscience ne peut plus juger des objets des sens que de manière affective, alors que les consciences des sens sont innocentes en elles-mêmes.
Comment le réaliser ?
Dans la méditation, on va débrancher le mental passionné. En ralentissant l’esprit on peut analyser clairement ce que sont les phénomènes qui nous entourent dans la vision pénétrante. On ralentit le flot des pensées et on ouvre l’espace, ce qui fait le plus peur à l’ego. La méditation est si difficile, on rame et on lutte tant, car le mental passionné ne veut pas lâcher prise. On se focalise sur le contenu des émotions ou des pensées plutôt que les voir comme de simples mouvements dans l’esprit. C’est une différence considérable avec l’Occident, où le terme méditation renvoie à une sorte de rumination de l’esprit sur un thème conceptuel. C’est une mécompréhension quant à la méditation. La peur de la psychologie est la perte du moi. On pense que s’il n’y a plus cette existence du moi, il ne reste plus rien, aucune structure. Mais pour le bouddhisme c’est une erreur car le moi n’est pas notre véritable nature, qui est cet esprit non fabriqué, à la base du mental ordinaire. C’est l’esprit vide et lumineux, c’est-à-dire connaissant ; non-dualiste, il n’entre pas dans la distinction entre sujet et objet.
Interview par Nicolas d'Inca.
Source du texte : Psychologie et méditation
Suite de l'interview (2e partie) : Psychologie et méditation
L'émission "Sagesse bouddhiste" reçoit Philippe Cornu sur "Qu'est-ce que la conscience ?"
Commande sur Amazon.
Votre nouvelle traduction du Livre des morts tibétain se base sur des versions tibétaines plus fiables, et elle donne la perspective véritable de ce texte en lui rendant son arrière-plan doctrinal issu de la tradition dzogchen.
L’idée principale de ce travail était de retraduire directement du tibétain, parce que jusqu’ici le texte traduit de l’anglais n’avait pas un vocabulaire adéquat. Il n’était pas lié au dzogchen alors que le texte est nyingmapa. C’est en combinant les pratiques tantriques et celles du dzogchen que le Bardo Thödol se présente comme une sorte de kit complet pour travailler avec son esprit dans la vie, pour se préparer au moment de la mort et tirer les leçons des expériences post-mortem afin d’en percevoir le côté libérateur. Tout cela ne paraissait pas clair dans les éditions précédentes, c’est pourquoi j’ai voulu donner tous les textes et les expliquer un par un. Il fallait donc repartir du texte proprement dit, corrigé de préférence, ce qui a été possible grâce à Dudjom Rinpoché, qui a fait une édition critique en tibétain où il rétablit la justesse du texte. Il fallait ensuite replacer le livre dans sa tradition. Sinon, c’est un texte qui flotte dans une aura de fantastique qui prête le flanc à toutes les projections fantasmatiques de l’Occident. Les exposés sur la nature de l’esprit font pourtant partie du noyau du Bardo Thödol, et sans eux on se retrouve avec des textes descriptifs et spectaculaires qui nous parlent de visions, de déités, etc. Cela paraît exotique voire psychédélique, ce qui a donné lieu aux délires de Timothy Leary sur l’usage du Livre des morts lors des voyages au LSD, alors que cela n’a rien à voir. Cela fausse la compréhension, parce que LSD ou pas, tant que les visions sont vues sous l’angle dualiste, elles ne sont pas libératrices et ne ramènent pas à la vraie nature de l’esprit.
Vous expliquez aussi comment Jung n’a pas compris l’Orient et en particulier ce texte ?
Ce qui est intéressant est de voir pourquoi Jung n’a pas compris la méditation à partir des catégories occidentales. La psychologie, et Jung avec elle, dépend de la pensée philosophique de Descartes, selon laquelle l’esprit est une substance pensante et non une substance étendue. Cela circonscrit l’esprit comme un espace clôt, avec des objets intérieurs à cet esprit, des représentations mentales. Avec la psychologie freudienne, cet esprit est à nouveau divisé entre conscient et inconscient puis avec Jung entre inconscient individuel et collectif. Jung a ramené ce qu’il comprenait du bouddhisme et de la méditation à ses propres catégories, il en a fait une voie royale vers l’inconscient avec tous les dangers que cela suppose. C’est pourquoi il recommande au Occidentaux de ne pas se risquer dans la méditation. Cela vient d’un présupposé selon lequel l’accès offert par la méditation serait celui de l’inconscient, alors que ce n’est pas le cas pour le bouddhisme où il n’est jamais question de cela. Certes, des choses sont sous-jacentes à la conscience, c’est ce qu’on appelle les tendances karmiques. Un karma est toute action motivée par le désir de perpétuer le sentiment du moi. Ce moi est illusoire, jamais véritablement constitué, tout le temps à reconstruire ; mais nous lui attribuons une solidité qui serait le noyau fixe de notre individualité. Pour le bouddhisme il n’y a qu’un courant de conscience en transformation perpétuelle. Nos intentions égocentriques produisent des imprégnations karmiques qui laissent une trace dans la conscience. Elles restent sous-jacentes jusqu’à ce que causes et conditions soient réunies pour donner naissance à une situation existentielle nouvelle. C’est un cycle sans fin, mais il n’y a pas l’idée d’un inconscient séparé.
Qu’entend-on par conscience dans le bouddhisme ?
Il y a huit types de conscience selon l’école de « l’esprit seul » (en sanscrit Vijnanavada, Cittamatra ou Yogacara). Cette approche, reprise par le dzogchen, décrit l’esprit à son niveau fonctionnel et relatif, l’esprit conditionné qui tourne à faux, qui ne comprend pas ce qui se produit et l’interprète, créant le sentiment de l’ego et d’un monde extérieur. Cet épiphénomène prend toute la place et masque le fait que sous cet esprit se trouve le non-duel, inconditionné, ouvert : la nature éveillée. D’abord on trouve les cinq consciences actives des sens ; puis la conscience mentale, qui à l’aide de représentations ordonne une conception du monde cohérente. Puis sont définies deux consciences qui rendent compte de la continuité de l’esprit dans les moments où les six consciences actives s’arrêtent, dans le sommeil profond par exemple. Est alors posée l’idée d’une conscience sous-jacente qui ferait le lien entre divers moments de conscience ou même entre plusieurs vies. C’est la conscience « base universelle », alayavijñana. C’est un lieu neutre où se déposent les imprégnations des karmas créés sous l’influence de l’ego. La septième conscience est le mental passionné ou souillé, klistamanas, c’est un aspect de l’esprit qui est en quête d’un support solide et stable. Il prend alors l’alayavijñana, la huitième conscience, pour le moi. C’est le Q.G. de l’ignorance, qui entretient le sentiment du moi par une cogitation constante. Comme tout est fugace, ce mental essaie de reconstruire l’ego en permanence. La septième conscience ne peut plus juger des objets des sens que de manière affective, alors que les consciences des sens sont innocentes en elles-mêmes.
Comment le réaliser ?
Dans la méditation, on va débrancher le mental passionné. En ralentissant l’esprit on peut analyser clairement ce que sont les phénomènes qui nous entourent dans la vision pénétrante. On ralentit le flot des pensées et on ouvre l’espace, ce qui fait le plus peur à l’ego. La méditation est si difficile, on rame et on lutte tant, car le mental passionné ne veut pas lâcher prise. On se focalise sur le contenu des émotions ou des pensées plutôt que les voir comme de simples mouvements dans l’esprit. C’est une différence considérable avec l’Occident, où le terme méditation renvoie à une sorte de rumination de l’esprit sur un thème conceptuel. C’est une mécompréhension quant à la méditation. La peur de la psychologie est la perte du moi. On pense que s’il n’y a plus cette existence du moi, il ne reste plus rien, aucune structure. Mais pour le bouddhisme c’est une erreur car le moi n’est pas notre véritable nature, qui est cet esprit non fabriqué, à la base du mental ordinaire. C’est l’esprit vide et lumineux, c’est-à-dire connaissant ; non-dualiste, il n’entre pas dans la distinction entre sujet et objet.
Interview par Nicolas d'Inca.
Source du texte : Psychologie et méditation
Suite de l'interview (2e partie) : Psychologie et méditation
L'émission "Sagesse bouddhiste" reçoit Philippe Cornu sur "Qu'est-ce que la conscience ?"
lundi 18 octobre 2010
Monko
John Cage, 4'33'' (en trois mouvements).
Pas d'image ni de vidéo, juste un pseudo, Monko, et un blog sur lequel l'auteur répond à qui lui pose des questions : Non dualité canal blog
Deux extraits, le premier en réponse à une demande concernant son cheminement, le second commentant une citation de Ramana Maharshi.
Si vous avez une question à lui poser c'est ici : Monko
Bonjour Odile,
Je suppose qu'on peut partir de ma passion pour la musique. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un grand attrait pour la musique, le phénomène sonore. J'en suis rapidement passé à la pratique, jusqu'à faire mes études dans la musique et la musicologie. Bien sûr, au début, ma pratique et mes intérêts étaient-ils relativement conventionnels, jusqu'à ce que tout cela soit, disons, un peu plus sérieux avec l'abord du jazz et l'improvisation "tonale", intérêt qui m'a rapidement quitté. Ensuite, mon esprit fut rapidement tourné vers les expérimentations en tous genres, moi-même pratiquant alors ce que l'on appelle "l'improvisation non-idiomatique", ne reposant sur aucun schéma ou entente préalable, sinon l'amour du son dans tous ses états. Bien sûr, tout cela restait purement lié à une histoire "personnelle", une passion esthétique, phénoménale, mentale, sensuelle peut-être, etc...
Puis je fis une rencontre artistique déterminante en la personne (et surtout la musique et l'approche) de John Cage dont l'intérêt se situait dans le silence, la non-intention, l'indétermination, la préférence marquée pour les questions plutôt que les réponses: en effet, à travers son approche des philosophies orientales et du zen en particulier, il en est venu à aborder la composition musicale par la pratique exclusive de ce qu'il appelait "les opérations de hasard", abandonnant ainsi tout velléité d'écrire une musique liée à ses goûts et dégoûts ou même écoute intérieure, comme on dit: il utilisait le yi-king, l'antique livre chinois, posait des questions et laissait le livre répondre.. Ces opérations de hasard étaient appelées par lui "ma méditation".... Si bien que je perçus rapidement que sa musique n'était au fond qu'une expression du silence sans cesse palpable. Il liait pour moi expérimentations et beauté. Enfin, il termina sa vie comme un sage; et je sentis que ma pratique musicale ne me mènerait jamais à cette sagesse, alors j'ai voulu remonter à la source, et c'est comme cela que je me suis impliqué dans le zen, et y reçus l'ordination.
Puis tout change: c'est dans le zen que je fis la rencontre de mon maître et ami, Pierre-Michel Trémeau, par qui l'expérience spirituelle se révéla. Nous devînmes amis, et il me fit découvrir l'enseignement de Jean Klein à travers les livres puis celui, vivant cette fois, de Francis Lucille, disciple de Jean Klein, par qui la compréhension s'enracina, je dirais se ramifia... Je fis pendant zazen et à travers l'enseignement de mon ami l'expérience d'une forme de transparence, d'une non-différenciation intérieur-extérieur, d'une non-localisation de l'être, de la Conscience, de son caractère absolu, impersonnel et intemporel, et de la non-existence d'une quelconque entité personnelle. La non-dualité devint "ma" voie, le zen m'ayant plus ou moins quitté depuis... Toute compréhension est abrupte, mais l'enracinement en elle peut recquérir le temps, le temps que le mental et le corps s'accordent eux-mêmes à la réalité, à la révélation-révolution de leur véritable nature en laquelle ils trouvent toute leur potentialité. C'est ainsi que cela fonctionne pour moi, je crois. Ayant conscience du caractère tout-à-fait anecdotique de tout cela, je te fais mes amitiés. A bientôt.
"Voyez celui qui voit et vous trouverez que tout est le Soi. Changez votre façon de voir, regardez vers l'intérieur." Ramana Maharshi
Pourrais-tu expliquer cette formulation ?
Bonjour D,
La première des choses qui me paraît importante à souligner, c'est que Ramana n'exhorte pas ici à trouver le Soi ou la Conscience comme il est souvent dit par ailleurs, mais de voir qui est réellement cette apparente entité qui fait des expériences, qui semble penser, voir, entendre, goûter, etc... De voir où est le centre d'où le regard semble jaillir pour aller attraper les objets. Ceci est très important parce que dans les voies où on exhorte à entrer en contact avec une Conscience englobante, un silence englobant, il est possible que cette expérience continue à être l'expérience "de quelqu'un", et finalement on est pas plus avancé. Alors certes Ramana ne le dit pas comme ça, mais pour moi, il dit tout simplement, "plutôt que de tenter de découvrir l'unicité, voyez qu'il n'est personne"...
Il s'agit de prendre clairement conscience que nous nous prenons pour un centre d'où part le regard; et ce regard est en fait une tension qui crée une séparation intérieur/extérieur et un monde entièrement dédié à la gloire du regardeur séparé, auquel nous accollons toute une histoire, avec passé/présent/futur. Et ce centre voyant n'est en fait jamais expérimenté et n'existe qu'à l'état de croyance, de concept. Et ainsi tous nos problèmes viennent de dehors, des autres.... Alors, Ramana dit simplement: voyez celui qui voit. Retournez l'attention. On pourrait dire, "arrêtez de diriger l'attention vers un extérieur, arrêtez d'être si attentifs!". Et en retournant l'attention, ou même simplement l'intérêt, ce qui est vu, c'est strictement rien, car il n'existe aucun regardeur, aucune entité attentive séparée dans cette tête, dans ce corps, dans ce monde. Le regard est nulle part et partout, ne va ni ne vient, est conscient de tout sans un seul instant être spécialement attentif. Là, la tension peut s'écrouler, la séparation intérieur/extérieur aussi. Alors le monde perd sa rigidité, sa réalité séparée et se révèle comme étant de la même substance que ce regard clair, silencieux, énergétique. Le monde n'est que lumière.
Suite (voir message du 02 octobre 2010) sur : Non dualité canal blog
MAJ (21.10.12) :
lundi 4 octobre 2010
Franklin Merrell Wolf
Franklin Merrell Wolff (1887-1985) a enseigné les mathématiques et la philosophie à Harvard et Berkeley. Il se consacra à l’éveil de la conscience, notamment par l'étude et l'intégration de l'oeuvre de Shankara, éveil dont il témoigna de la reconnaissance en 1936 après vingt quatre ans de recherche.
Site officiel : Merrell-Wolf
Bibliographie (en français) :
- Expérience et philosophie. Ed. du Relié.
- Une expérience spirituelle, Philosophie de la conscience. Ed. du Relié.
1. La Conscience-sans-objet est.
2. Avant que les objets ne soient, la Conscience-sans-objet est.
3. Alors que les objets semblent exister, la Conscience-sans-objet est.
4. Lorsque les objets disparaissent, cependant la Conscience-sans-objet est, demeurant inaffectée à travers toutes choses.
5. En dehors de la Conscience-sans-objet, il n’est rien.
6. Au sein de la Conscience-sans-objet réside le pouvoir d’attention qui projette les objets.
7. Lorsque les objets sont projetés, le pouvoir d’attention en tant que sujet est présupposé, cependant la Conscience-sans-objet demeure inchangée.
8. Lorsque la conscience des objets naît, alors semblablement, surgit la conscience de l’absence d’objets.
9. La conscience des objets est l’Univers.
10. La conscience de l’absence d’objets est le Nirvana.
11. Dans Conscience-sans-objet se trouvent à la fois l’univers et le Nirvana, cependant pour la Conscience-sans-objet, les deux sont identiques.
12. Dans la Conscience-sans-objet réside la semence du Temps.
13. Lorsque l’attention connaît le Temps, naît alors la connaissance de l’intemporalité.
14. Etre conscience du Temps, c’est être conscience de l’Univers, et être conscient de l’Univers, c’est être conscient du Temps.
15. Reconnaître l’intemporalité c’est atteindre le Nirvana.
16. Mais pour la Conscience-sans-objet, il n’est aucune différence entre Temps et Intemporalité.
17. Dans la Conscience-sans-objet se trouve la semence de l’Espace contenant-le-monde.
18. Lorsque l’attention connaît l’Espace contenant-le-monde, alors la connaissance de la Vacuité Spatiale est née.
19. Etre conscient de l’Espace contenant-le-monde, c’est être conscient de l’Univers des Objets.
20. Reconnaître la Vacuité Spatiale, c’est s’éveiller à la Conscience nirvanique.
21. Mais pour la Conscience-sans-objet, il n’est pas de différence entre l’Espace contenant-le-monde et la Vacuité Spatiale.
22. Dans la Conscience-sans-objet se trouve la Semence de la Loi.
23. Lorsque naît la conscience des objets, la Loi est invoquée comme une Force qui tend toujours vers l’Equilibre.
24. Tous les objets existent en tant que tensions dans la Conscience-sans-objet et ont toujours tendance à se muer en leurs propres attributs ou en d’autres.
25. L’effet ultime du passage de tous les objets à leurs pôles complémentaires est l’annulation mutuelle dans un Equilibre complet.
26. La conscience est le champ des tensions dans l’Univers.
27. La conscience de l’Equilibre est le Nirvana.
28. Mais pour la Conscience-sans-objet, il n’y a ni tension ni Equilibre.
29. L’état de tension est l’état du devenir-permanent.
30. Le devenir-permanent est le mourir-sans-fin.
31. Ainsi, l’état de la conscience des objets est un état de promesses toujours renouvelées qui passent dans la mort au moment de leur accomplissement.
32. Si bien que, lorsque la conscience est attachée aux objets, l’agonie de la naissance et de la mort ne cesse jamais.
33. Dans l’état d’Equilibre, où la naissance annule la mort, la Béatitude sans-mort du Nirvana est reconnue.
34. Mais la Conscience-sans-objet n’est ni agonie ni béatitude.
35. A partir de la Grande Vacuité, qui est la Conscience-sans-objet, l’Univers est projeté de façon créatrice.
36. L’univers est expérimenté comme la négation créée qui résiste toujours.
37. L’acte créateur est béatitude ; la résistance peine sans fin.
38. La résistance sans fin est l’Univers de l’expérience ; l’agonie de la crucifixion.
39. La créativité incessante est le Nirvana, la Béatitude qui dépasse la conception humaine.
40. Mais pour la Conscience-sans-objet, il n’est ni créativité ni résistance.
41. Le toujours-devenir et le toujours-cesser-d’être sont de l’action sans fin.
42. Lorsque le toujours-devenir annule le toujours-cesser-d’être, le Repos est reconnu.
43. L’Action incessante est l’Univers.
44. Le Repos sans fin est le Nirvana.
45. Mais la Conscience-sans-objet n’est ni l’Action ni le Repos.
46. Lorsque la conscience est attachée aux objets, elle est réduite par les formes imposées par l’Espace contenant-le-monde, par le Temps et par la Loi.
47. Lorsque la conscience se déprend des objets, on atteint la libération quant aux formes de l’Espace contenant-le-monde, du Temps et de la Loi.
48. L’attachement aux objets est la conscience confinée à l’Univers.
49. La Libération vis-à-vis de cet attachement est l’état de Liberté Nirvanique illimitée.
50. Mais la Conscience-sans-objet n’est ni l’esclavage ni la liberté.
51. La Conscience-sans-objet peut-être symbolisée par un ESPACE qui est indifférent à la présence ou à l’absence d’objets et pour Elle il n’est ni Temps ni Intemporalité ; ni Espace contenant un monde, ni Espace Vide, ni Tension, ni Equilibre ; ni Résistance ni Créativité ; ni Souffrance ni Félicité ; ni Action ni Repos ; et ni Limitation ni Liberté.
52. Le GRAND ESPACE n’étant pas identifiable à l’Univers, ne peut pas non plus être identifié au moindre Soi.
53. Le GRAND ESPACE n’est pas Dieu, mais cela qui engloble tous les Dieux, ainsi que toutes les autres créatures.
54. Le GRAND ESPACE, ou Conscience-sans-objet, est la Seule Réalité dont tous les objets et tous les soi dépendent et tirent leur existence.
55. Le GRAND ESPACE englobe à la fois la Voie de l’Univers et la Voie du Nirvana.
56. Rien ni personne n’existe hormis le GRAND ESPACE.
Extrait de : Une expérience spirituelle – Philosophie de la conscience.
Inscription à :
Articles (Atom)